Dîner-débat du 5 avril 2018

Mosaïque des philosophes (Pompéi)
Qui d’entre nous ne souhaite pas sincèrement que démocratie et culture marchent main dans la main ? Le drame qui vient d’endeuiller la France montre pourtant que les choses ne sont pas si simples, et que l’idéal démocratique peut être confronté à ses propres limites, et parfois même obligé de reconnaître son impuissance face à des formes de « culture » totalement inassimilables. Car le mot « culture », il faut le rappeler d’emblée, recouvre aussi bien l’ensemble des conditionnements et habitus collectifs (mœurs, mentalités) propres à un groupe social donné, que le processus de « formation » – ce que les Allemands nomment Bildung – grâce auquel chaque individu est appelé à réaliser pleinement son humanité ; laquelle n’est jamais une donnée de fait, d’ordre biologique ou social, mais une construction volontaire et une victoire sur tous les obstacles qui en menacent la réalisation. Quel peut être de ce double point de vue le rôle de la démocratie, et de l’idéal humain qui est le sien ?
Car la démocratie est d’abord une notion politique définissant un certain type de pouvoir émanant directement du peuple et non pas d’un roi ou d’un dictateur, d’une oligarchie ou d’une ploutocratie. La démocratie fait à cet égard figure de rempart contre la tyrannie et l’arbitraire, et c’est là un premier trait qu’elle partage avec la culture censée elle aussi permettre une résistance, au moins intellectuelle et spirituelle, à toutes les formes d’oppression et de barbarie : « Être cultivé ne veut rien dire d’autre qu’être libéré », disait le poète Rainer Maria Rilke[1]. Pensons à la force de résistance puisée dans la lecture des poètes par les détenus des camps soviétiques ou nazis ! Que ces deux idéaux libérateurs puissent parfois spontanément converger reste une de nos espérances les plus fortes et les plus chères, même si elle est parfois démentie par les faits.
Le type de gouvernement issu de ce pouvoir populaire est d’autre part intimement lié, pour nous autres Français, avec l’idée que nous nous faisons de la République, indivisible et fraternelle, au sein de laquelle chaque citoyen jouit en principe d’une liberté de conscience et d’un droit d’expression que nul ne saurait lui contester, ni n’a le droit de confisquer. Or, c’est là aussi à nos yeux la vocation de la culture, dans sa dimension à la fois individuelle et collective, que de sensibiliser les esprits à ces droits humains fondamentaux, et d’apprendre à en user non seulement en vue de son intérêt personnel, mais avec le souci du bien commun. La culture n’est pas en soi démocratique, mais la manière dont un peuple use du pouvoir décisionnel qui est le sien dépend de la culture qu’il a acquise et qui, loin de se limiter au présent, plonge ses racines dans le passé. De même, si ce n’est pas la démocratie en tant que telle qui favorise nécessairement la culture, il faut être cultivé ou au moins éduqué pour être vraiment démocrate. Rien ne dit pour autant que l’idéal démocratique puisse régir tous les aspects de la vie privée et publique, et c’est sans doute là où nous demandons à la démocratie davantage qu’elle ne peut donner.

Proclamation de la 3°Répubique le 4 septembre 1870.
L’idée que nous nous en faisons aujourd’hui est en tout cas intimement liée à l’évolution de la culture occidentale, au point même qu’on peut voir dans l’idéal démocratique une sorte de perfectionnement culturel parvenu à son apogée, à sa pleine maturité. On aura beau nous répéter que les Grecs ont « inventé la démocratie », une césure d’environ deux mille ans sépare l’idée finalement très inégalitaire qu’ils s’en faisaient de la manière dont nous nous efforçons de la pratiquer aujourd’hui. L’idéal démocratique est d’ailleurs différemment perçu dans d’autres cultures qui, soit le désapprouvent ou le haïssent, soit en rêvent comme d’un futur pour elles encore inaccessible. Ainsi le philosophe iranien Daryush Shayegan disait-il considérer la démocratie comme le moins nuisible et à ce titre le meilleur des régimes politiques, tout en ajoutant : « Je sais aussi qu’elle est difficilement transposable, puisqu’elle implique toute une culture civile et civique dont beaucoup de pays sont dépourvus, n’ayant pas subi le même processus historique.[2] » Quoi qu’il en soit, les pratiques démocratiques témoignent de l’émancipation des esprits prônée par la philosophie des Lumières, et donc relativement récente dans notre propre histoire. En est-il de même pour la culture ?
Force est de reconnaître que les grandes cultures du passé, celles dont nous admirons aujourd’hui encore les œuvres impérissables, ne furent pas ou très rarement l’expression d’un idéal démocratique, du moins au sens propre du mot. Ce constat s’applique en tout premier lieu à la culture européenne, dont les réalisations ont été rendues possibles par des régimes politiques rien moins que démocratiques et dans la majorité des cas monarchiques, voire quelque peu tyranniques ; et cela aussi bien à l’âge des cathédrales, dans la Florence des Médicis qu’au Siècle de Louis XIV. En bref, notre patrimoine culturel témoigne d’une créativité artistique et d’une tournure d’esprit élitiste qui ne doivent pas grand chose à la démocratie, sauf à considérer que le christianisme, qui a modelé en profondeur la culture européenne, est en son essence foncièrement démocratique ; ce qui n’est ni tout à fait vrai compte tenu de son histoire, ni totalement faux si on se réfère aux Évangiles et à la vie des premières communautés chrétiennes.
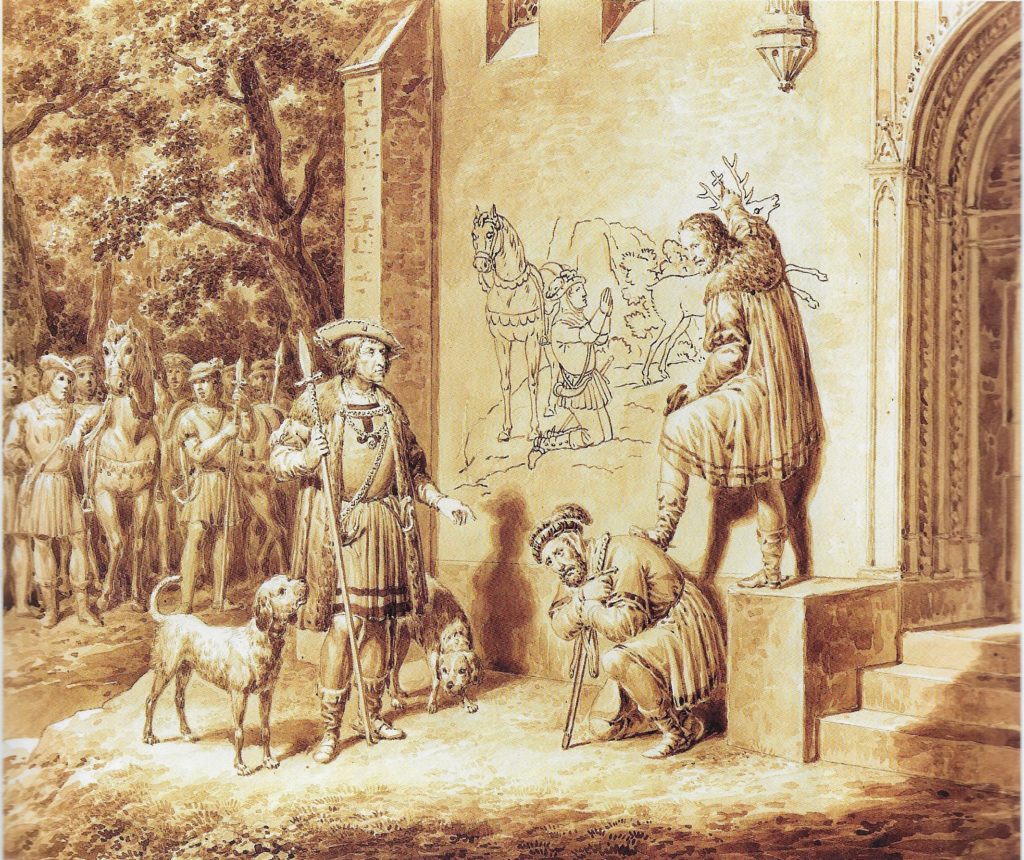
Albrecht Dürer et l’empereur Maximilien 1°
Rien ne permet non plus de penser que les artistes se servaient jadis de la protection aristocratique dont ils jouissaient pour faire passer des idées plus libérales, et pour tout dire déjà démocratiques et modernes. Cette vision rétrospective du passé est une illusion d’optique qui se révèle d’autant plus fausse qu’on interroge la capacité des démocraties modernes à produire une grande culture comparable à celles que nous admirons, tout en regrettant qu’elles n’aient pas été plus démocratiques. Cette réécriture du passé à la lumière de nos idéaux modernes est par ailleurs d’autant plus contestable que démocratie et culture sont actuellement toutes deux en crise – d’identité, d’efficacité, de légitimité – et en sont même venues à douter de leur finalité respective. Or, cette crise est aussi celle de la modernité dans son effort semble-t-il assez vain pour se réinventer sans cesse – on parle aujourd’hui de post ou d’hyper modernité – tout en faisant table rase du passé. Aussi est-ce un des paradoxes de la culture moderne d’avoir fait de nous des « héritiers sans passé », comme j’ai tenté de le montrer dans l’essai portant ce titre[3].
Que constate-t-on en effet de nos jours quant aux pratiques démocratiques ? Les électeurs boudent les urnes, des mouvements « populistes » émergent, qui semblent menacer le consensus démocratique ; la méritocratie est en berne, et les écoles deviennent des foyers d’insécurité et parfois même d’inculture. On ne peut donc éluder la question : si la démocratie est le pouvoir exercé par le peuple, qu’est aujourd’hui devenu ce peuple ? On parle d’ailleurs couramment de masse(s), de public, de population(s), et rarement de peuple sinon pour mettre en garde contre le populisme. En dehors des élections – principal rendez-vous entre peuples et démocratie – on s’en remet aux sondages comme on consultait jadis les haruspices : ce que Léon Bloy nommait « le sacre de la Multitude[4] ». Déstabilisé par la mondialisation et les flux migratoires incontrôlés, le peuple, ou ce qu’il en reste, a désormais le sentiment que le pouvoir véritable est en d’autres mains que les siennes : puissances financières, lobby en tous genres, réseaux mafieux. D’où sa désaffection pour les rendez-vous électoraux, et la multiplication des « initiatives citoyennes » destinées à contrecarrer un jeu démocratique jugé truqué ou vain.
Que vaut d’ailleurs la démocratie si les citoyens ne savent pas réellement ce qu’ils font en mettant leur bulletin dans l’urne ? On connaît les débats à propos de la valeur très hypothétique du suffrage universel ! La pratique démocratique suppose non seulement que les citoyens soient correctement informés, mais suffisamment cultivés pour mesurer le poids des mots et des idées ; suffisamment courageux aussi pour prendre leurs responsabilités dans toutes les situations inédites créées par la vie en commun dans une démocratie dite libérale et avancée mais fragilisée par ses propres principes. Dans un livre récent (L’imposture du vivre-ensemble)[5], Paul-François Paoli note très justement que la cohésion républicaine repose moins sur des valeurs, comme on ne cesse de le répéter, que sur des vertus qui seules obligent car elles interdisent tout relativisme ; des vertus démocratiques donc, et pas la vertu au sens où l’entendait Montesquieu pour opposer ce régime fondé sur la rigueur morale des citoyens à la monarchie (honneur) ou la tyrannie (crainte).
Mais le talon d’Achille de la démocratie n’est peut-être pas sa fragilité politique, et la rechute toujours possible vers une forme ou une autre de totalitarisme et de tyrannie. Il pourrait bien se révéler interne à la vie collective en démocratie, et à la relative stérilité culturelle qui est devenue la sienne. Ce n’est pas la création d’un Ministère de la culture qui favorise les créations d’envergure, alors même que ledit Ministère ne parvient que difficilement à sauvegarder le patrimoine français, en péril comme chacun sait. Plus que de budget, c’est de vocation qu’il s’agit ; et l’on constate que la culture ne saurait être administrée avec succès par de hauts fonctionnaires si elle n’irrigue plus, ne fertilise plus au quotidien les activités et les pensées d’une collectivité qui se trouverait par là même soudée, dynamisée. La fréquentation des musées nous apprend en effet que la grandeur d’une culture se mesure aussi bien au façonnage des objets utilitaires qu’à la représentation grandiose de ses dieux. Si la démocratie a de ce point de vue modelé la culture postmoderne, c’est en la rendant à son image résolument matérialiste et profane ; rien ne permettant pour autant d’affirmer qu’un autre régime politique aurait fait mieux.

André Malraux composant son Musée imaginaire.
Il se peut aussi que l’idéal de vie démocratique, tourné vers la bonne gestion des affaires publiques et l’égalité des citoyens devant la loi, ne soit guère favorable aux grandes épreuves et aventures de l’esprit auxquelles nous associons la notion de « culture » en nous référant à celles des œuvres qui ont traversé le temps et acquis une renommée universelle. Que serait en effet une démocratie aboutie sinon une société devenue pleinement consensuelle, sans conflits internes ni ennemis, comme l’a montré Pascal Bruckner dans un essai déjà ancien (La mélancolie démocratique, 1990) ? Or, cette « mélancolie des entreprises achevées », pour parler comme Nietzsche, n’a pas grand chose à voir avec la mélancolie généreuse et créatrice qui était selon Aristote l’apanage des hommes de génies, et inspira quelques-unes des grandes œuvres – celle d’Albrecht Dürer par exemple – qui nous émerveillent encore aujourd’hui. Peut-on concevoir la culture sans dénivelés, sans épreuves à surmonter, sans disparités consenties et non plus subies ? Il est donc à craindre que le culte de l’égalité à tout prix finisse par abolir les différences que la démocratie se vante pourtant de respecter et de promouvoir, et sans lesquelles il n’est pas de culture vivante.
L’égalitarisme idéologique tel qu’on le pratique aujourd’hui au nom de la démocratie pourrait ainsi contribuer à ruiner le sens de l’équité sans lequel il n’est ni vie démocratique ni culture, mais une sorte de mélange indigeste des deux. Non, tout ne se vaut pas. Une vie humaine vaut davantage qu’un téléphone portable, et un Rembrandt qu’un graffiti. Que vaut elle-même la culture si « tout est culture » comme on tente de nous le faire croire afin d’en finir avec toutes les hiérarchies ? Tout était sans doute « culture » quand une cohérence spirituelle forte faisait d’une société un organisme vivant, comme ce fut plus ou moins le cas durant les siècles où le christianisme modela l’ensemble des activités qui ont elles-mêmes façonné la culture européenne, du tailleur de pierre au Roi très chrétien. C’est cette cohérence et cette continuité, propres à une tradition spirituelle solidement implantée, que la modernité a choisi de briser au profit d’une aventure certes passionnante mais risquée, tant pour la démocratie que pour la culture.
C’est donc une chose de favoriser l’accès de tous les citoyens à ce que la culture a produit de plus digne d’être admiré ; mais c’en est une autre de leur en faciliter l’approche au point de niveler toutes les difficultés (vulgarisation), et d’abolir par démagogie toutes les différences entre les productions culturelles afin de leur épargner l’effort d’apprendre à discerner ce qui élève l’esprit de ce qui le rend encore plus médiocre. Il ne s’agit plus alors là que d’un idéal démocratique dévoyé, avilissant la démocratie tout en stérilisant le processus de culture qu’Antoine de Saint Exupéry nommait « l’ensemencement de l’être humain », et qui ne pouvait d’après lui se faire que « par le haut »[6]. L’histoire nous apprend en effet qu’il n’y a pas de culture digne de ce nom qui n’ait imposé un ordre de grandeur sans quoi la démocratie devient démagogie, et la culture un simple divertissement offert à une population désireuse de tuer agréablement le temps.
La démocratie ne peut donc que s’avilir quand la culture devient elle-même un bien de consommation, un engouement saisonnier ou un instrument de propagande idéologique. On ne peut dès lors éluder la question : à quoi bon tant d’activités culturelles si aucune excellence n’en émerge ? La finalité ultime de la culture, comme de la démocratie, n’est-elle pas de faire naître une nouvelle « aristocratie » qui, loin de jouir égoïstement de ses privilèges, devient un exemple pour tous et une incitation pour chacun à se construire soi-même en toute liberté, mais en se sentant redevable à l’endroit de ce qui fait autorité ? Or, ce n’est pas la démocratie qui est capable, à elle seule, d’enseigner le discernement quant à ce qui mérite d’être imité, et le joueur de foot bénéficie aujourd’hui d’un net avantage médiatique sur le médecin, le savant ou l’homme politique. D’où vient alors cette impulsion vers le meilleur si elle ne relève pas simplement de la curiosité intellectuelle ou du goût des performances ? D’une forme ou une autre de religiosité oserai-je dire, d’un sens du sacré que l’on voit aujourd’hui se déplacer sur des terrains profanes où sa célébration fanatise les foules.
Si la postmodernité a tant de mal à faire converger démocratie et culture, c’est probablement qu’en fait elles divergent quant à la vision et l’usage de l’universel. On peut craindre en effet que l’Europe, et la France en particulier, soient prises au piège d’une universalité abstraite que les droits démocratiques ont contribué à valoriser alors que la culture ne peut porter l’universel, et l’offrir à l’humanité, qu’à partir de singularités, de particularités sensibles et concrètes : des visages, des paysages, des couleurs et des sonorités, des figures divines…La culture française, ce ne sont pas seulement les « droits de l’homme » mais une langue et une manière de vivre, d’entrer en relation avec autrui, de préparer les aliments et de construire des maisons en fonction de l’environnement. Du moins en fut-il ainsi durant des siècles. La démocratie assure dans les meilleurs des cas les conditions sans lesquelles nous considérons aujourd’hui que la culture ne peut exister et rayonner ; on ne peut lui en demander davantage, et le reste est à réinventer. Mais le désirons-nous, et en sommes-nous encore capables ?
La question de fond doit donc être posée, comme le fit déjà en 1955 Albert Camus dans un discours sur « l’avenir de la civilisation européenne » : « Le vrai problème est de savoir si nous voulons survivre en tant que civilisation. […] Ce n’est donc pas la raison qui passe d’abord, c’est l’instinct de vivre[7] ». Ajoutons : et de vivre en accord avec nos convictions profondes, autant dire avec la culture dont nous sommes les héritiers ; des héritiers devenus conscients de leur passé, de sa grandeur et de ses vicissitudes, et bien décidés à en transmettre à leur tour ce qui mérite de l’être. C’est dans ce sursaut vital qu’il faut chercher la véritable rencontre de la démocratie et de la culture et leur fécondation réciproque, et non dans une nouvelle idéologie prétendument réconciliatrice : « La culture c’est l’effusion raffinée de la vie dans l’organisme en éveil de l’homme », écrivait en 1936 le poète Antonin Artaud[8]. Éveillons-nous donc avant qu’il ne soit trop tard, en bons démocrates et en individus épris de culture.
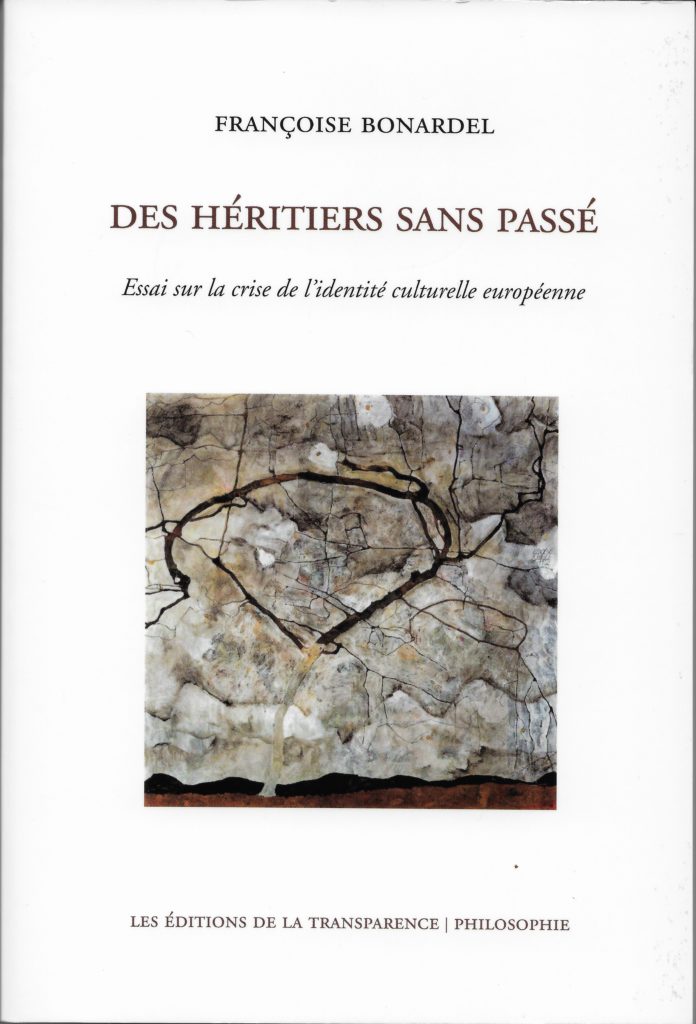
[1] R. M. Rilke, Journal florentin, trad. M. Betz, Paris, l’école des lettres, 1998, p. 38.
[2] D. Shayegan, Sous les ciels du monde – Entretiens avec Ramin Jahanbegloo, Paris, Éditions du Félin, 1992, p. 61.
[3] Des Héritiers sans passé – essai sur la crise de l’identité culturelle européenne, Chatou, Les Éditions de la Transparence, 2010. Actuellement indisponible en librairie, cet ouvrage peut être commandé sur le site de l’auteur.
[4] L. Bloy, Exégèse des Lieux Communs, Payot, Rivages poche, 2005, p. 50.
[5] Voir la recension de cet ouvrage publiée dans Figarovox le & février 2018.
[6] A. de Saint Exupéry, Carnets, Paris, Gallimard Folio, 1999, p. 73.
[7] A. Camus, Conférences et discours (1936-1958), Paris, Gallimard Folio, 2017, p. 239.
[8] A. Artaud, Messages révolutionnaires, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1971, t. VIII p. 225.
