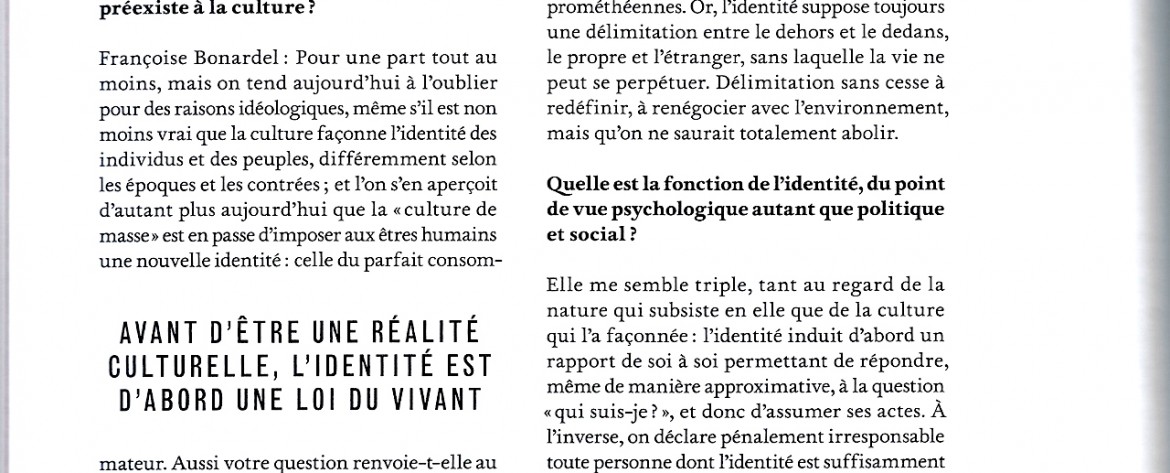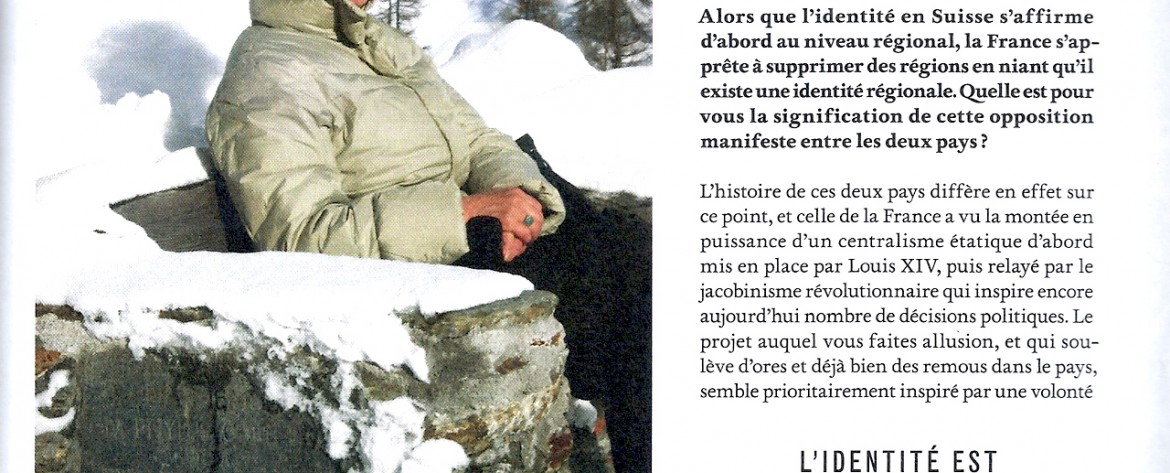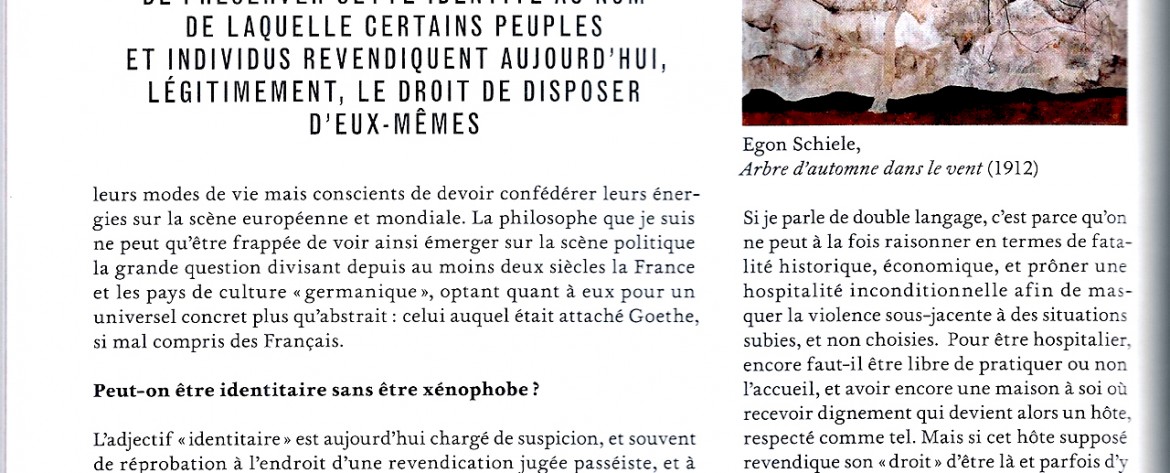A.D. L’identité est-elle une réalité qui préexiste à la culture?
F.B. Pour une part tout au moins, mais on tend aujourd’hui à l’oublier pour des raisons idéologiques, même s’il est non moins vrai que la culture façonne l’identité des individus et des peuples, différemment selon les époques et les contrées ; et l’on s’en aperçoit d’autant plus aujourd’hui que la « culture de masse » est en passe d’imposer aux êtres humains une nouvelle identité : celle du parfait consommateur. Aussi votre question renvoie-t-elle au vieux débat entre nature et culture, et je ne sais jusqu’à quel point on pourra continuer à dissocier nature et identité, comme on tente de le faire aujourd’hui, sans provoquer des réactions compensatoires qui risquent d’être d’une rare violence.
Car l’identité commence, sous des formes encore très rudimentaires, avec l’apparition de chaque être vivant, doté d’une existence autonome tout en appartenant à un genre, une espèce et un environnement. L’identité ne peut donc être dissociée ni de l’individualité ni de l’ensemble plus vaste dont elle tient les caractéristiques permettant de l’identifier. Avant d’être une réalité culturelle, l’identité est d’abord une loi du vivant que la culture va aménager mais ne peut totalement transformer. Et c’est cet équilibre toujours fragile que les sociétés hypermodernes tentent aujourd’hui de bouleverser, comme s’il n’était plus aucune limite à leurs ambitions prométhéennes. Or, l’identité suppose toujours une délimitation entre le dehors et le dedans, le propre et l’étranger, sans laquelle la vie ne peut se perpétuer. Délimitation sans cesse à redéfinir, à renégocier avec l’environnement, mais qu’on ne saurait totalement abolir.
A.D. Quelle est la fonction de l’identité, du point de vue psychologique autant que politique et social ?
F.B. Elle me semble triple, tant au regard de la nature qui subsiste en elle que de la culture qui l’a façonnée : l’identité induit d’abord un rapport de soi à soi permettant de répondre, même de manière approximative, à la question « qui suis-je ? », et donc d’assumer ses actes. A l’inverse, on déclare pénalement irresponsable toute personne dont l’identité est suffisamment perturbée pour qu’elle n’ait pas à « répondre » de ce qu’elle a fait. Aussi l’identité est-elle également un signe de reconnaissance offert au monde extérieur – ce que Carl Gustav Jung nomme la persona – permettant aux autres de se situer par rapport à nous, mais aussi de nous évaluer, et parfois de nous juger. Le fait d’offrir une image de soi à peu près lisible répond à des exigences sociales très pragmatiques tout en fondant les relations entre individus sur une civilité élémentaire même si, bien sûr, les relations humaines sont toujours infiniment plus complexes que cela. Enfin, l’existence d’une identité individuelle ou collective à peu près stable et reconnaissable suppose qu’elle va pour l’essentiel perdurer dans le temps, et fonde donc la possibilité de la transmission de génération en génération, autant dire la survie même de la culture, tant du point de vue collectif qu’en tant que processus de « formation » individuelle (Bildung).
A.D. Pourquoi associe-t-on donc si souvent la notion d’identité à celle de repli sur soi, voire d’ostracisme à l’endroit de tout ce qui n’est pas soi ? Est-ce là un risque inhérent à la notion même d’identité ?
F.B. Certainement pas car ce serait gommer ce qui constitue la dynamique même de l’identité bien comprise, à savoir l’élasticité, la capacité d’adaptation et d’évolution sans laquelle le vivant lui-même serait voué à la mort. Je récuse donc la logique simpliste, inspirée par l’idéologie mondialiste, selon laquelle le noyau identitaire d’une personne ou d’un peuple, forgé par sa propre histoire, serait un obstacle à son dialogue avec autrui. Raisonner ainsi revient à méconnaître le fait qu’aucune identité n’a pu survivre sans devoir composer, s’adapter, tout en préservant ce qui la différencie et fait qu’elle n’est pas absorbée par plus puissant qu’elle. Mais un être enfermé dans une identité supposée immuable se révèle tout aussi vulnérable, par excès de protectionnisme cette fois-ci.
Assumée dans sa complexité par contre, l’identité est justement ce qui permet d’être suffisamment sûr de soi pour s’aventurer vers ce qui n’est pas soi, sans esprit de soumission ni de conquête. Elle est ce qui autorise à naviguer entre ces deux extrêmes et permet de se construire soi-même sur un pied d’égalité avec les autres et pas forcément contre eux, ni dans un rapport de dépendance à ces grands Autres que sont l’Etat, la Société, l’Eglise et maintenant l’Humanité qui tend à s’y substituer. Ce que résume à mon sens la belle formule du poète grec Pindare – « Deviens qui tu es » – reprise par Goethe puis par Nietzsche.
A.D. Alors que l’identité suisse est subsidiaire de celle des cantons et s’affirme d’abord au niveau régional, la France s’apprête à supprimer des régions en niant qu’il existe une identité régionale. Quelle est pour vous la signification de cette opposition manifeste entre les deux pays?
F.B. L’histoire de ces deux pays diffère en effet sur ce point, et celle de la France a vu la montée en puissance d’un centralisme étatique d’abord mis en place par Louis XIV, puis relayé par le jacobinisme révolutionnaire qui inspire encore aujourd’hui nombre de décisions politiques. Le projet auquel vous faites allusion, et qui soulève d’ores et déjà bien des remous dans le pays, semble prioritairement inspiré par une volonté de simplification administrative, sous-tendue par la nécessité de faire des économies. Mais il s’enracine en fait – ainsi le perçoit une part de l’opinion publique – dans le déni des spécificités régionales, supposées rétrogrades par rapport à la grande recomposition annoncée ; comme si le « régionalisme » allait ranimer les vieux démons du passé prérévolutionnaire et scinder la belle unité de la République, acquise de haute lutte contre les « factions », comme on disait au temps de la Révolution.
Mais ce qui est par ailleurs en jeu derrière ce débat, c’est la construction européenne : se fera-t-elle à partir des anciennes nations, sommées de renoncer à leurs privilèges identitaires au nom d’une Europe dont le visage devient au regard des peuples de plus en plus abstrait, technocratique ; ou à partir de ces unités territoriales et culturelles que sont les régions, porteuses d’une identité forte et pour cela désireuses d’entrer en dialogue avec les cantons, länder, etc., eux aussi attachés à leurs modes de vie mais conscients de devoir confédérer leurs énergies sur la scène européenne et mondiale. La philosophe que je suis ne peut qu’être frappée de voir ainsi émerger sur la scène politique la grande question divisant depuis au moins deux siècles la France et les pays de culture « germanique », optant quant à eux pour un universel concret plus qu’abstrait : celui auquel était attaché Goethe, si mal compris des Français.
A.D. Peut-on être identitaire sans être xénophobe?
F.B. L’adjectif « identitaire » est aujourd’hui chargé de suspicion, et souvent de réprobation à l’endroit d’une revendication jugée passéiste, et à ce titre dangereuse pour l’existence de cette entité de remplacement qu’est devenue l’Europe. Mais qui veut cette unification forcée sinon le pouvoir économique ? Le fait est par ailleurs que des groupes se disant « identitaires » usent souvent, pour se faire entendre, de moyens d’action violents, à l’endroit des ressortissants étrangers en particulier. Mais cette situation, potentiellement explosive, n’est-elle pas le fruit de bien des lâchetés politiques, et du double langage qui s’ensuit ?
Si le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » est l’un des grands acquis de la Révolution française et de l’esprit des Lumières, pourquoi ne serait-il pas applicable à tous les peuples, à commencer par ceux qui ont contribué plus que tous les autres à sa promotion dans le monde entier ? Or une des spécificités de l’ensemble des peuples constituant l’Europe repose justement sur son extrême diversité : de paysages, de climats, de langues et de traditions ; la confédération suisse étant à cet égard un ensemble très représentatif. Au nom de quoi cette diversité, qui fait l’admiration des visiteurs étrangers, ne mériterait-elle plus d’être préservée, aimée, transmise à ceux qui estimeront être nos héritiers, et cela indépendamment de leur origine ?
Si je parle de double langage, c’est parce qu’on ne peut à la fois raisonner en termes de fatalité historique, économique, et prôner une hospitalité inconditionnelle afin de masquer la violence sous-jacente à des situations subies, et non choisies. Pour être hospitalier, encore faut-il être libre de pratiquer ou non l’accueil, et avoir encore une maison à soi où recevoir dignement qui devient alors un hôte, respecté comme tel. Mais si cet hôte supposé revendique son « droit » d’être là et parfois d’y faire la loi, qu’on ne parle plus d’hospitalité ni d’accueil de l’étranger. On ne peut donc à la fois s’employer à détruire la maison d’accueil comme le prône l’idéologie mondialiste, et reprocher aux individus ou aux peuples d’être inhospitaliers, voire xénophobes. Or c’est ce qui est en train de se produire, et qui explique en partie les réactions « identitaires » qu’on ne peut se contenter de réprouver sans en chercher les causes, et tenter de les éradiquer.
Je dirai donc pour conclure que l’on court d’autant moins le risque de devenir xénophobe que l’on aura su se donner les moyens de préserver cette identité au nom de laquelle certains peuples et individus revendiquent aujourd’hui, légitimement, le droit de disposer d’eux-mêmes. Ce qui ne saurait se réaliser au détriment d’autrui, qui que soit cet autrui.
Françoise Bonardel
Interview parue dans la revue Market.
Françoise Bonardel – Philosophe, Professeur émérite à la Sorbonne et auteur (entre autres) de Des Héritiers sans passé – essai sur la crise de l’identité culturelle européenne, Chatou, Les Editions de la Transparence