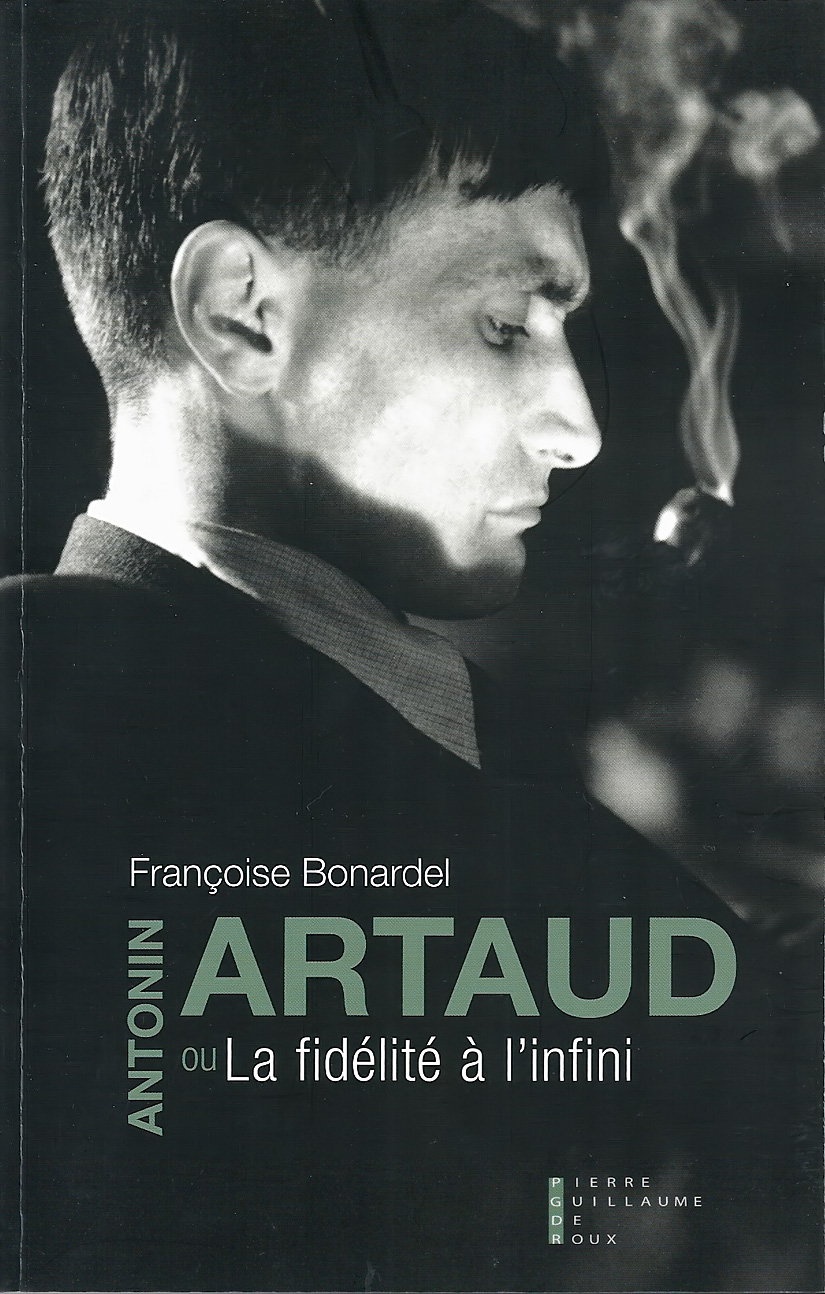
Conférence faite à Liège le 10 mai 2014 à l’invitation du centre d’art contemporain Les Brasseurs.
Lorsque Yannick Franck m’a proposé de venir vous parler d’alchimie – sujet auquel je m’intéresse depuis une vingtaine d’années – j’ai pensé qu’il pourrait être intéressant d’aborder cette question à travers l’expérience vécue d’un des plus grands écrivains contemporains de langue française – Antonin Artaud (1896-1948) – qui fut aussi acteur de cinéma et de théâtre, et l’auteur de Le Théâtre et son Double, un manifeste en faveur d’une rénovation radicale de la théâtralité publié en 1938 alors qu’Artaud venait d’être interné après un voyage en Irlande très mouvementé. Or, il y a dans cet ouvrage, composé de courts essais à première vue disparates rédigés entre 1931 et 1935, un texte intitulé « Le théâtre alchimique » (1932) qui retient particulièrement l’attention puisqu’Artaud affirme d’entrée qu’ « il y a entre le principe du théâtre et celui de l’alchimie une mystérieuse identité d’essence[1]. » Laquelle, nous demandons-nous aussitôt ? Artaud parle en effet du « principe » du théâtre et pas simplement du sujet de la pièce, de la mise en scène ou du jeu des acteurs. Ce qui laisse entendre que c’est la théâtralité en tant que telle qui l’intéresse, et qui ne se limite pas forcément à ce qui se passe sur une scène de théâtre.
Au dire de ses contemporains par exemple, Artaud se comportait dans la vie de manière souvent très « théâtrale », tout en invitant ses contemporains à redevenir les « acteurs » de leur propre existence. D’autre part, les références à l’alchimie dans ses écrits ne concernent pas seulement le théâtre mais aussi la guérison de sa maladie et celle de la culture occidentale qu’il jugeait décadente puis, plus tard, la confection d’un « corps sans organes » qu’il entreprendra durant ses années d’enfermement à l’asile de Rodez. Tout comme le héros Gilgamesh parti à la recherche de la plante d’immortalité, c’est une panacée (remède universel) qu’espérait découvrir Artaud comparant parfois sa quête à celle du Graal : « Il me faut ce dont l’opium terrestre n’a été que l’inversion pervertie » disait-il (XVI, 41)[2], ajoutant : « Il faut prendre l’héroïne de terre et la retransmuter pour en faire une poudre de survie » (XIX, 247). Toute son œuvre me semble donc traversée par un mythe de guérison d’inspiration alchimique qui donne son unité, sa cohérence profonde à ses écrits dont certains viennent seulement d’être publiés (Cahiers d’Ivry I et II) tandis que d’autres sont peu lus (Cahiers de Rodez, Cahiers du retour à Paris), en raison de leur difficulté sans doute et à défaut d’une clé permettant de les interpréter.
On peut en effet déplorer que cette œuvre immense (28 volumes d’Œuvres complètes !) soit rarement abordée dans son intégralité, et demeure trop souvent l’objet d’interprétations partielles ou de partis pris idéologiques selon lesquels Artaud, reniant en 1945 le christianisme, se serait définitivement libéré de l’aliénation religieuse et des préoccupations ésotériques qui auraient été pour partie la cause, ou en tout cas le signe manifeste de sa folie. C’est là un diagnostic qu’Artaud s’est toujours refusé à admettre, se définissant comme un « aliéné authentique » : un être que sa lucidité, sa recherche de l’essentiel et son intransigeance, rendaient étranger à ce monde qu’il jugeait corrompu. Le rapport d’Artaud à l’alchimie n’a donc à mon sens rien de ponctuel ni de fortuit, et répond au contraire à la forme de pensée qui est la sienne, et aux circonstances dramatiques liées à sa maladie puis à ses neuf années d’internement : « mes 9 ans de solitude et d’horreur », dira-t-il à sa sortie en 1946 (XIV*, 81). Libéré, Artaud fait depuis lors figure de poète maudit, de « suicidé de la société » tout comme Van Gogh sur qui il écrivit en 1947 un texte magnifique, remarquablement mis en scène dans l’exposition organisée par le Musée d’Orsay à Paris.
Pourquoi Artaud s’est-il senti si proche de Van Gogh ? En ce que cet « illuminé » est parvenu dans sa peinture à tirer des choses et des situations les plus concrètes et les plus simples « ces espèces de chants d’orgue, ces feux d’artifices, ces épiphanies atmosphériques, ce « Grand Œuvre » enfin d’une sempiternelle et intempestive transmutation[3]. » Or, la manière dont Artaud parvient à s’introduire dans les toiles de Van Gogh, la façon dont il reconstitue de l’intérieur le geste qui les a faites venir au jour montre à quel point cette alchimie créatrice lui est familière. C’est d’ailleurs en décrivant certains tableaux des maîtres anciens – Lucas de Leyde, Jérôme Bosch, Peter Bruegel – ou ceux d’un peintre contemporain comme Balthus, qu’Artaud a plus d’une fois tenté d’expliquer ce qu’était à ses yeux la dimension alchimique de la théâtralité ; comme si la peinture permettait un accès plus direct que les mots à cet univers dont René Alleau évoquait en ces termes l’étrangeté très théâtrale : « Cet espace fermé, ces labyrinthes, ces lueurs soudaines, ces ténèbres, cette galerie de miroirs entre lesquels circulent des rois, des dragons, des enfants, des déesses nues, des couples d’amoureux, des musiciens, tout un peuple d’acteurs qui, cependant, ne montre point leur vrai visage, cette machinerie, ce théâtre, ces palais déserts, peu à peu, désorientent, troublent, égarent le voyageur dans leurs interférences comme par l’absence de tout critère extérieur de réalité[4]. »
Mais peut-être faut-il tout d’abord rappeler que l’alchimie, sous sa forme occidentale tout au moins, est un art traditionnel placé sous le patronage d’Hermès-Mercure-Thot et dont l’origine remonte à l’antiquité gréco-égyptienne. Quand je dis art, j’entends par là une pratique – une poïesis en somme – reposant sur une conception de la nature permettant d’envisager la transmutation des quatre éléments (eau, air, terre, feu) en un cinquième supposé parfait (quinte-essence) et, plus généralement, celle de toute matière vile en un corps incorruptible symbolisé par l’or. L’alchimie est donc à la fois une vision du monde, une technique opératoire et un état d’esprit.
Une vision du monde car l’Art d’Hermès tient son efficacité des « correspondances » existant entre microcosme et macrocosme (« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut »), induisant la possibilité de transformer conjointement l’esprit et la matière et d’obtenir ainsi le salut de l’homme comme celui de la Création. L’opération alchimique ne vise donc pas à dissocier corps et esprit mais au contraire à spiritualiser l’un tout en permettant à l’autre de s’incorporer, de s’incarner dans la matière. Un axiome attribué à Hermès le dit clairement : « Si tu ne dépouilles pas les corps de leur nature corporelle et si tu ne donnes pas une nature corporelle aux incorporels, rien de ce que tu attends n’aura lieu[5]. » On comprend alors mieux pourquoi Artaud, conscient dès ses jeunes années de « manquer de terre à tous les degrés » (1*, 141), a été si naturellement attiré par l’alchimie : « On ne perd pas l’esprit en descendant dans la matière, on gagne un esprit encore plus puissant », disait-il (XV, 332).
Les alchimistes recherchaient en effet dans leur pratique un équilibre entre ces deux opérations que sont la dissolution (solve) et la coagulation (coagula). C’est dans cette opération de haute précision que réside l’un des secrets de l’Œuvre dont les différentes phases sont marquées par l’apparition de couleurs (noir, blanc, rouge) reconnaissables par l’opérateur dont la transformation spirituelle s’effectue parallèlement à celle de la matière sur laquelle il veille attentivement, tout comme il veille à ce que le feu de cuisson ne calcine pas le compost : « Il y a une chaudière des êtres et c’est là que je les fais cuire en corps », écrit Artaud à Rodez (XIX, 181). Mais c’est un feu plus secret que l’alchimiste doit découvrir au cœur même de la matière – une étincelle de vie incréée, pourrait-on dire – dont l’ardeur savamment maîtrisée est seule capable de porter à son terme l’Opus chemicum. Artaud n’aurait sans doute pas projeté d’écrire un livre intitulé « Vie et mort de Satan le Feu » (1935) s’il n’avait eu conscience d’être exposé, du fait de sa maladie, à une calcination comparable à celle que redoutaient les alchimistes : « Un étrange mouvement de l’esprit me pousse à rechercher un principe, à le réduire alchimiquement ; et le moyen de la réduction c’est le feu » (VIII, 98). C’est aussi pourquoi le processus alchimique s’apparente à un drame – une guerre des principes dit souvent Artaud – au cours duquel s’affrontent principalement deux « acteurs » qui sont en fait les deux principes, masculin et féminin, dont dépend toute création (Soleil/Lune, Roi/Reine, Soufre/Mercure) et dont l’union (noces chimiques) va permettre la transmutation de la matière vile en Pierre philosophale.
Mais la pratique alchimique est aussi un état d’esprit, une manière à la fois compatissante et « cruelle » d’aborder la réalité. Compatissante, puisque l’alchimiste ne se résigne pas à laisser la Création dans l’état où il l’a trouvée : déchue au regard des chrétiens, inachevée selon les païens, mais en proie au mal et à la souffrance en tout cas. La voie de transformation dans laquelle l’alchimiste s’engage n’est toutefois ni active, au sens usuel du terme, ni purement contemplative mais opérative dans la mesure où l’opération effectuée va agir simultanément sur deux plans, matériel et spirituel à la fois ; et où sa réussite reste un don de Dieu en dépit du savoir-faire transmis par un maître qualifié, et par les traités dont le langage énigmatique demande, pour être pleinement compris, qu’on ait soi-même réalisé certaines des manipulations décrites. Si l’opération alchimique se révèle « cruelle » c’est en ce que rien ne peut dispenser d’affronter la réalité telle qu’elle se présente, fût-ce sous son jour le plus sombre ; la maladie puis l’enfermement pour Artaud par exemple, tirant cette leçon de ses épreuves : « On ne se lave pas de ses péchés dans les eaux du Gange, on les garde sur soi et on en fait d’autres qualités » (XX, 331).
C’est donc en assumant pleinement la mort symbolique d’une matière en putréfaction (nigredo) que l’alchimiste va pouvoir en extraire la prima materia : une force vierge, antérieure à toute forme créée, et regagnée sur la décomposition des corps putréfiés. C’est cette dialectique entre formes et forces, Artaud ne s’y est pas trompé, qui est au cœur du processus de transmutation assimilable à une initiation en ce qu’il dévoile un sens caché, à une régénération puisqu’il est censé procurer l’immortalité, et à une rédemption dans la mesure où l’âme et le corps sont ainsi sauvés de la corruption. La réalisation de l’Œuvre alchimique exige donc un engagement total qui répondait au caractère entier d’Artaud aspirant à une délivrance à la fois personnelle, théâtrale ou culturelle : « La vraie culture agit par son exaltation et par sa force, et l’idéal européen de l’art vise à jeter l’esprit dans une attitude séparée de la force et qui assiste à son exaltation […] Et s’il est encore quelque chose d’infernal et de véritablement maudit dans ce temps, c’est de s’attarder artistiquement sur des formes, au lieu d’être comme des suppliciés que l’on brûle et qui font des signes sur leurs bûchers [6].»
On pense évidemment à la scène du film de Carl Dreyer (La Passion de Jeanne d’Arc, 1928) où Artaud, jouant le rôle du moine Massieu, tend un crucifix à Jeanne ligotée sur son bûcher. Mais c’est aussi la puissance de la dramaturgie alchimique et de sa riche iconographie qui vient à l’esprit. On se pose alors la question : que connaissait-il au juste de l’alchimie hormis ce que l’observation de son propre état lui enseignait ? Force est de reconnaître qu’on ne sait pas grand-chose des lectures qui furent sans doute les siennes, et qui confortèrent ses intuitions quant à l’importance culturelle et spirituelle d’une philosophie de la nature et d’une pratique avec lesquelles il se sentait tant d’affinités naturelles et que résume cette étonnante formule : « J’ai de l’esprit une idée matérielle, bien que j’aie une philosophie antimatérialiste de la vie. » (VIII, 236). On sait par contre qu’Artaud fut dans ses jeunes années très proche du Docteur René Allendy (1889-1942), auteur d’ouvrages sur la médecine homéopathique, sur Paracelse, le médecin maudit (1937), et sur la psychanalyse dont il fut l’un des pionniers en France avec Marie Bonaparte.
L’influence d’Allendy fut indéniable sur Artaud, mais ne suffit pas à expliquer l’exceptionnelle intelligence du processus alchimique qui a été la sienne. On en vient donc à penser qu’il fut attiré par l’alchimie tant en raison de son tempérament personnel, réfractaire au rationalisme occidental qu’il jugeait pathologique, que de sa maladie à laquelle la médecine classique n’apporta aucun espoir de guérison ou au moins de rémission : « Mon effroyable destinée m’a mis depuis longtemps en dehors de la raison humaine, en dehors de la vie […] J’ai brûlé cent mille vies humaines déjà, le comprends-tu enfin, à force de douleurs » écrit-il en 1923 à son amie la comédienne Génica Athanasiou[7]. Aucun médecin ne fut en effet capable d’identifier et de traiter le mal qui devait ruiner son existence d’homme, et le contraindre à inventer des stratégies de survie proches de celle mise en œuvre par les anciens alchimistes : « Je ne sépare pas le bon grain de l’ivraie, je fais du grain avec de l’ivraie » (XVIII, 46). Il était donc logique qu’il se tourne vers ce que nous appellerions aujourd’hui des médecines « parallèles », entretenant avec l’ancienne alchimie des rapports plus ou moins étroits.
Tout semble donc parti du sentiment, éprouvé par Artaud dès son plus jeune âge, d’avoir été jeté malgré lui, malade incurable qui plus est, dans un monde raté par son Créateur où ceux qu’il nommera dans ses dernières années les « initiés » exercent impunément la magie la plus noire. Ainsi écrit-il en 1946 à Marthe Robert : « La vérité est que les choses ne sont plus normales et que ce monde ci est en train de tomber. Ce qu’on appelle l’apocalypse dans les livres est en réalité depuis longtemps commencé mais il y a toujours de derniers imbéciles pour oublier des journaux afin de croire que ce monde tient quand il s’en va. » (XIV*, 110). Ce corps et ce monde malades il aurait pu décider, comme certains mystiques et gnostiques, de les renier et de s’en échapper. Telle n’est pas la voie qu’il a choisie d’emprunter mais celle de l’alchimie, imposant de se confronter à la réalité et d’en réaliser la transmutation grâce à la confection d’un nouveau corps – le fameux « corps sans organes » – évoluant dans un monde délivré de la corruption après un « combat d’apocalypse » qui prend une place de plus en plus grande dans ses derniers écrits.
Artaud ne s’est donc pas contenté d’explorer le lien profond entre transmutation alchimique et théâtralité. À l’alchimie il emprunte aussi l’idée que, si une guérison peut advenir, elle concernera la Création tout entière et ne saurait se limiter à la scène théâtrale. C’est aussi pourquoi l’alchimie était appelée à jouer un rôle central dans sa quête d’une thérapeutique personnelle et collective au regard de laquelle Dieu lui-même sera contraint de s’expliquer sur sa Création où le mal l’emporte sur le bien : « Je ferai quelque chose de la merde tandis que Dieu n’a jamais fait que de la merde de tout. » (XII, 229).
La manière même dont Artaud décrit son mal révèle qu’il se sentait affecté dans sa vitalité, et comme vampirisé par une force de dissociation et de mort lui interdisant de se sentir « entier » et d’entrer pleinement en contact avec la réalité : « C’est moi, un être dont la nature est de ne jamais pouvoir se prendre entièrement » (XX, 10). Mais ce qui frappe plus encore dans les descriptions d’une grande précision qu’il effectue de son état – un état « hors la vie » dit-il – est qu’il ne conçoit pas le corps comme un mécanisme susceptible d’être réparé par pièces détachées, mais comme un réseau énergétique soumis à des influences subtiles dont le contrôle échappe à la médecine classique : « Et maintenant, Monsieur le docteur, j’espère que vous saurez me donner la quantité de liquides subtils, d’agents spécieux, de morphine mentale, capables d’exhausser mon abaissement, d’équilibrer ce qui tombe, de réunir ce qui est séparé, de recomposer ce qui est détruit » (1*, 53).
Devançant le corps médical dans la prescription d’une thérapeutique adaptée à son état, Artaud lui donne spontanément la forme du solve et coagula alchimique. De même le voit-on se tourner spontanément vers l’acupuncture, qui lui apporta une certaine amélioration de son état, et s’intéresser dans le même temps à la médecine alchimique telle qu’elle fut pratiquée par Paracelse, le grand médecin suisse (1493-1541), avant de donner naissance à l’homéopathie : « Dans cette conception nouvelle la maladie ne dépouille pas le malade mais lui ajoute une sécurité, une richesse, elle le fait s’élever d’un plan » (VIII, 289). Nous dirions aujourd’hui qu’Artaud avait une vision « holistique » de la santé comme de la maladie qui ne pouvait que le rapprocher de l’alchimie considérant comme une totalité la triade corps-âme-esprit.
Mais le rapport d’Artaud à la maladie se révèle complexe dans la mesure où ce mal qui le « tantalise » lui ouvre aussi des horizons inconnus et le force à s’interroger sur l’étroite imbrication de la mort et de la vie et sur la « force d’alchimie » capable de transmuer la mort en vie et le chaos en poésie : « Il m’a fallu être assez malade pour trouver de nouvelles forces même dans ma maladie », écrit-il dans les Cahiers de Rodez (XVII, 83). Et dans un texte plus tardif (1946), Artaud confesse avoir davantage appris de la maladie qu’il n’aurait pu le faire de la « bonne santé » pour laquelle il n’a que mépris quand elle est une donnée naturelle dispensant de « sonder la vie » afin d’extraire du chaos originel une nouvelle énergie : « Pas de malade qui n’ait grandi. Pas de bien portant qui n’ait un jour trahi, pour n’avoir pas voulu être malade, comme tels médecins que j’ai subis. J’ai été malade toute ma vie et je ne demande qu’à continuer. Car les états de privation de la vie m’ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites-bourgeoises de LA BONNE SANTE SUFFIT[8]. »
Passionné par le théâtre dès ses jeunes années, Artaud n’aurait donc probablement pas écrit le « Théâtre de la Cruauté » si la maladie n’avait été pour lui la scène « cruelle » d’une dénudation et d’une mise à mort qui devaient faire de lui un initié, comme le mage antique Apollonius de Tyane auquel il s’identifia à l’époque où il écrivait Héliogabale (1934), puis un ressuscité tel le Christ dont il dira avoir subi la Passion au Golgotha. On a en effet le sentiment qu’Artaud ne s’est tant intéressé à la dimension alchimique de la théâtralité que parce qu’il n’envisagea à aucun moment d’en limiter les effets à la scène théâtrale. Réciproquement, le théâtre qu’il espère faire revivre ne sera « alchimique » que parce qu’il renouera avec l’esprit des Mystères antiques, de la tragédie grecque, du drame élisabéthain ; parce qu’il sera « métaphysique », « essentiel », « ésotérique » dit encore Artaud multipliant à son propos les qualificatifs. Un drame sacré en somme, une catharsis « cruelle » dont le spectateur ne sortira pas indemne mais bouleversé, transformé, régénéré. Jusqu’à la fin de sa vie en tout cas Artaud resta persuadé qu’il était encore pour lui possible de réaliser le Théâtre de la Cruauté supposé libérer la culture de son temps des Doubles qui la vampirisaient. Ainsi écrit-il en 1947 : « Mais que la conscience universelle désire ou non un changement et qu’elle le désire sur le point que je dis, c’est le moment ou jamais pour le théâtre de reprendre sa véritable et antique fonction de transmutation organique des membres les plus intimes du corps humain[9]. »
Cette amplification métaphysique ne l’a pas empêché de mettre en lumière de manière extrêmement imagée et précise les liens à la fois spirituels et concrets entre le drame alchimique et la dramaturgie scénique. Le fait que certains recueils de traités alchimiques anciens portent le titre de « Théâtre chimique » (Theatrum chemicum) n’a pas manqué de retenir son attention toujours en alerte : « Il faut d’ailleurs, avant d’aller plus loin, remarquer l’affection étrange que tous les livres traitant de la matière alchimique professent pour le terme de théâtre, comme si leurs auteurs avaient senti dès l’origine tout ce qu’il y a de représentatif, c’est-à-dire de théâtral, dans la série complète des symboles par lesquels se réalise spirituellement le Grand Œuvre, en attendant qu’il se réalise réellement et matériellement[10]. » Mais Artaud était trop subtil pour s’en tenir à la description extérieure d’une opération qui, si elle est effective, se déroule simultanément sur la scène qu’elle transforme en creuset, en foyer vibrant, et dans le corps de l’acteur. Aussi a-t-il compris que c’est sur ces deux plans que l’alchimie théâtrale opère simultanément, tout comme l’ancienne alchimie agissait à la fois sur le petit monde, enfermé dans le vase de verre, et sur le cosmos tout entier : « L’alchimie représente la projection d’un drame à la fois cosmique et spirituel en termes de ‘laboratoire’. L’opus magnum avait comme but aussi bien la délivrance de l’âme humaine que la guérison du Cosmos », disait Mircea Eliade[11].
Encore faut-il qu’au théâtre le texte ne prenne plus le pas sur la mise en scène. Sur ce point aussi Artaud prend résolument à rebours les idées de son temps puisque la mise en scène telle qu’il la conçoit consiste moins à planter un décor et à diriger des acteurs qu’à susciter une effervescence proche du chaos, à déchaîner des forces suffisamment puissantes pour balayer les formes convenues (décors, personnages, situations) afin de confronter l’homme à quelques-uns des grands « principes » métaphysiques qui sont les maîtres de son destin. Tout comme l’alchimie, le théâtre opère en vase clos ; et c’est la « clôture de la représentation » (J. Derrida) qui donne toute son intensité au drame qui s’y joue : « Le théâtre est né des ténèbres comme la lumière du chaos, et comme elle il émerge pour vaincre les ténèbres du chaos » (VIII, 207). Ces idées révolutionnaires, subversives, et qui devaient influencer tant de metteurs en scène contemporains, Artaud les a exprimées non seulement dans Le Théâtre et son Double mais dans de nombreux textes écrits lors de son séjour au Mexique (1936) où devint plus évident encore à ses yeux le lien entre théâtre, culture et alchimie : « Être cultivé c’est brûler des formes, brûler des formes pour gagner la vie. C’est apprendre à se tenir droit dans le mouvement incessant des formes qu’on détruit successivement. » (VIII, 165).
La « cruauté » telle qu’Artaud entendait la remettre en œuvre au théâtre suscite donc bien une forme d’anarchie, poétique il s’entend, mais n’a rien de sadique ou de gratuit. Loin de s’adresser aux plus bas instincts humains, elle réveille au contraire en l’homme une rectitude morale, une lucidité tragique face à son destin : « J’emploie le mot de cruauté dans le sens d’appétit de vie, de rigueur cosmique et de nécessité implacable, dans le sens gnostique de tourbillon de vie qui dévore les ténèbres, dans le sens de cette douleur hors de la nécessité inéluctable de laquelle la vie ne saurait s’exercer », écrit-il en 1932 à Jean Paulhan[12]. C’est donc la vie, insiste Artaud, qui est en soi cruelle ; et le rôle du théâtre est à la fois de réveiller ces forces sombres et d’en exorciser les effets dans une action qui doit pour ce faire demeurer virtuelle, c’est-à-dire toujours à mi-chemin du réel et du songe. Aussi peut-on comparer la cruauté ainsi définie à la force de dissolution préparant en alchimie une nouvelle coagulation, plus rare et plus pure.
Le virtuel n’est donc pas pour Artaud un monde parallèle doublant le réel ou rivalisant avec lui, comme on tend à le penser aujourd’hui. La virtualité est au sens propre une vertu (virtus), une force aussi ambiguë que la vie elle-même, qu’il convient de purifier et d’orienter pour en faire un instrument de salut. S’il ne s’agissait que de déchaîner des forces de destruction – ce qui est le cas dans nombre de productions artistiques contemporaines – la cruauté pactiserait avec elles et se révélerait incapable d’en réaliser la transmutation. Elle n’aurait donc aucune vertu thérapeutique et contribuerait à la mort de la culture. Or, c’est un antidote à la dégénérescence culturelle de son temps que recherchait Artaud, pensant l’avoir trouvé dans une théâtralité rendue à sa dimension opérative, alchimique et donc cathartique : « Si l’époque moderne est en pleine catastrophe c’est parce qu’elle a perdu le sens de la vie universelle. Et il y a des moyens matériels de saisir les forces synthétiques de la vie » (VIII, 230).
Tous ces ingrédients sont réunis dans Héliogabale (1934) où Artaud laisse libre cours à son imagination fiévreuse et brosse de l’empereur dévoyé un portrait haut en couleurs qui est un peu le sien : celui d’un « insurgé de génie » à qui revient la gloire d’avoir « introduit le théâtre et par le théâtre la poésie sur le trône de Rome[13] ». Pas n’importe quelle poésie on s’en doute, mais une poésie tenant son pouvoir insurrectionnel de l’anarchie dont elle est issue, et sa raison d’être de la transmutation qui grâce à elle s’accomplit ; et c’est dans plusieurs creusets, emboités les uns dans les autres, que se déroule cette cruelle et flamboyante alchimie. Un creuset moyen-oriental d’abord puisque le drame se déroule en Syrie au bas-empire, dans une atmosphère torride et effervescente, à l’image des paysages désertiques entourant le temple d’Emèse où l’on vénère le dieu solaire Elgabalus. À ce deuxième creuset qu’est le temple lui-même, où se déploie une intense activité et dont les fondations s’enfoncent en spirales dans les entrailles de la terre, Artaud a consacré plusieurs descriptions suggérant qu’il s’agit bien à ses yeux d’un gigantesque athanor : « Une masse d’or jetée dans un gouffre alimenté par des cyclopes, à l’instant précis où le Grand Sacrificateur ravage frénétiquement la gorge d’un grand vautour, et en boit le sang, répond à une idée de la transmutation alchimique des sentiments en formes et des formes en sentiments, sur le rite passé par les prêtres égyptiens[14].»
Ce ne sont pourtant encore là que des enceintes extérieures abritant le creuset le plus secret où va se jouer le drame : Héliogabale lui-même dont l’activisme, anarchique et païen, met en péril l’esprit romain et latin tout en s’insurgeant contre les préceptes moraux des chrétiens : « Ce qui différencie les païens de nous, c’est qu’à l’origine de toutes leurs croyances, il y a un terrible effort pour ne pas penser en hommes, pour garder le contact avec la création entière, c’est-à-dire avec la divinité[15]. » C’est ce rapport direct entre l’homme et le divin que recherche à l’époque Artaud, convaincu que l’Orient « a permis de garder le contact avec la Tradition[16] ». Et si l’on reconnaît là l’influence de René Guénon, la résolution du conflit que préconise Artaud – poétique, anarchique et alchimique – n’a rien de « traditionnel » au sens où l’entendait Guénon qui trouva les idées d’Artaud « un peu confuses, mais intéressantes[17]», mais à qui il reprocha d’avoir sous-estimé l’importance du symbolisme. Une critique au demeurant injuste puisqu’Artaud a au contraire insisté sur le fait qu’en alchimie les symboles sont des « états philosophiques de la matière » mettant l’esprit « sur la voie de cette opération qui permet, à force de dépouillement, de repenser et de reconstituer les solides suivant cette ligne spirituelle d’équilibre où ils sont enfin redevenus de l’or[18] ».
Mais revenons à Héliogabale, un être en qui se mêlent masculin et féminin et dont l’androgynie, vécue sur un mode parodique, évoque néanmoins le mariage des opposés alchimique faisant de lui un être à la fois solaire et lunaire aux pouvoirs incontrôlables et surhumains. Des pouvoirs dont il va abuser, jusqu’au moment fatidique où ses excès déchainent contre lui la vengeance du peuple et le conduisent à une mort sordide. Qu’Héliogabale ait été aux yeux d’Artaud l’acteur par excellence, apparaît dans ces réflexions sur l’existence d’un souffle vital issu du chaos, antérieur donc à la respiration ordinaire qui est en fait portée par lui : « Or, ce qui dans le corps humain représente la réalité de ce souffle, ce n’est pas la respiration pulmonaire qui serait à ce souffle ce que le soleil dans son aspect physique est au principe de la reproduction ; mais cette sorte de faim vitale, changeante, opaque, qui parcourt les nerfs de ses décharges, et entre en lutte avec les principes intelligents de la tête. Et ces principes, à leur tour, rechargent le souffle pulmonaire et lui confèrent tous ses pouvoirs[19].»
Rien ne pourrait en effet avoir lieu sur scène si le corps de l’acteur n’était le théâtre d’une transmutation interne donnant naissance à un nouveau corps invisible et subtil, construit et dynamisé par le travail du souffle. Artaud n’a jamais varié sur ce point et les derniers textes – « Le Théâtre et l’anatomie » (1946) et « Aliéner l’acteur » (1947) – font écho aux tout premiers – « Un athlétisme affectif », « Le Théâtre de Séraphin » – dans lesquels il élabore une alchimie du souffle qu’il dit inspirée par la Cabale juive et par l’acupuncture chinoise. Selon l’acupuncture en effet le corps est un réseau de fins canaux (méridiens) reliant de multiples points (centres d’énergie) sur lesquels doit apprendre à s’appuyer l’acteur afin de maîtriser et diriger son souffle en fonction des différentes émotions qu’il souhaite exprimer : « Connaître les localisations du corps, c’est donc refaire la chaîne magique. Et je peux avec l’hiéroglyphe d’un souffle retrouver une idée du théâtre sacré[20]. » C’est donc tout le corps, en ce qu’il a de plus subtil, qui participe au jeu de l’acteur découvrant par là même qu’il existe au moins trois types de souffles – masculin, féminin et neutre – correspondant à la fois aux trois principes alchimiques – Soufre, Mercure, Sel – et à ces trois fonctions respiratoires que sont l’expir, l’inspir et un état neutre de vide ou de parfaite stabilité comparable à l’or alchimique en qui s’équilibrent les opposés : « Toute émotion que l’or équilibre est une émotion qu’on ne peut oublier », écrit-il dans Héliogabale[21].
Il semble donc qu’Artaud a voulu transposer au théâtre certaines pratiques d’alchimie interne d’origine taoïste ou tantrique, et a par là même découvert l’existence d’une respiration autre que pulmonaire sur laquelle il mettra l’accent dans ses derniers écrits relatifs au « corps sans organes » qui ne peut à l’évidence respirer avec ses poumons comme le corps ordinaire. Or, cette refondation de l’anatomie ne fait que renforcer la « mystérieuse identité d’essence » entre le principe du théâtre et celui de l’alchimie. Durant les années passées à Rodez, Artaud s’est en effet livré à d’étranges opérations visant à façonner un corps définitivement libéré des fonctions digestives et reproductrices, et donc de la mort : « Nous sommes ici-bas dans un être qui n’est pas le nôtre et qui est représenté par un corps qui n’a pas été fait pour notre âme ni pour l’âme et où l’âme étouffe sans fin. » (XI, 85). Se sentant à l’étroit dans ce « corps de mort », Artaud reprend à son compte la vieille plainte, d’origine orphique et platonicienne puis chrétienne, relative à l’enfermement et à l’exil de l’âme dans le corps. Mais ce n’était là pour lui qu’un premier pas le conduisant non pas à suivre l’âme dans son envol hors du charnier corporel mais à l’incorporer de telle sorte que prenne forme un nouveau corps, imputrescible celui-là car délivré des besoins grossièrement humains (alimentation, sexualité) ; un corps qu’on a parfois comparé au « corps glorieux » chrétien, ou au « corps de diamant » issu des pratiques alchimiques tantriques. Qu’en est-il dès lors de la respiration propre à ce corps ? On aurait pu s’attendre à ce qu’il respire comme ce parfait « athlète du cœur » qu’est censé être l’acteur, mais il n’en est rien. Est-ce à dire qu’Artaud renie l’alchimie du souffle qu’il avait précédemment élaborée sur des bases corporelles qui semblaient pourtant fiables ?
C’est moins en fait d’un reniement qu’il s’agit que d’un changement de stratégie justifié par la lutte incessante menée contre les prédateurs supposés le déposséder de sa substance vitale. Au fil des années en effet, le sentiment d’être laminé par la maladie s’est transformé en obsession d’être vampirisé par une force anonyme indifféremment nommée « dieu » ou « esprit ». Or esprit et souffle sont de même nature, aérienne et fluidique, et l’homme qui respire, fût-ce en parfait acteur, se rend vulnérable au « rapts furtifs » perpétrés par l’esprit. Aussi le « corps sans organes » doit-il se prémunir contre les prédateurs et autres envoûteurs en projetant sur eux son souffle, que plus rien ne distingue de la masse impénétrable qu’il est devenu : « Au lieu de faire un corps avec le souffle se faire tout un corps en soufflant, chaque corps étant venu d’une montagne de souffles » (XIX, 241). La pratique alchimique se transforme alors en pur exorcisme, pratiqué à tout moment par ce corps « qui souffle sans respirer, / qui respire sans aspirer, / qui soupire sans inspirer » (XVIII, 295). S’agit-il encore de théâtralité ou d’une « magie » condensant en elle toutes les ressources de l’alchimie ? La magie, dit en effet Artaud, « est tout simplement d’imposer silence aux êtres par la force du souffle volonté et pensée » (XIV*, 108).
Quoi qu’il en soit, Artaud n’a jamais renié l’esprit et le mode opératoire de la pratique alchimique dont le caractère supposé « fantastique » avait fasciné les surréalistes, mais dont il est l’un des rares poètes et dramaturges du XX° siècle à avoir compris qu’elle pouvait être la thérapeutique répondant aux besoins des hommes d’aujourd’hui encore capables comme lui d’en entendre et mettre en œuvre, sur la scène de leur choix, le message intemporel tel qu’il l’avait transcrit dans « Le Théâtre et l’alchimie » : « Résoudre ou même annihiler tous les conflits produits par l’antagonisme de la matière et de l’esprit, de l’idée et de la forme, du concret et de l’abstrait, et fondre toutes les apparences en une expression unique qui devait être pareille à l’or spiritualisé[22]. »
Conférence donnée à l’occasion de la réédition de Antonin Artaud ou la fidélité à l’infini, Paris, Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2014.
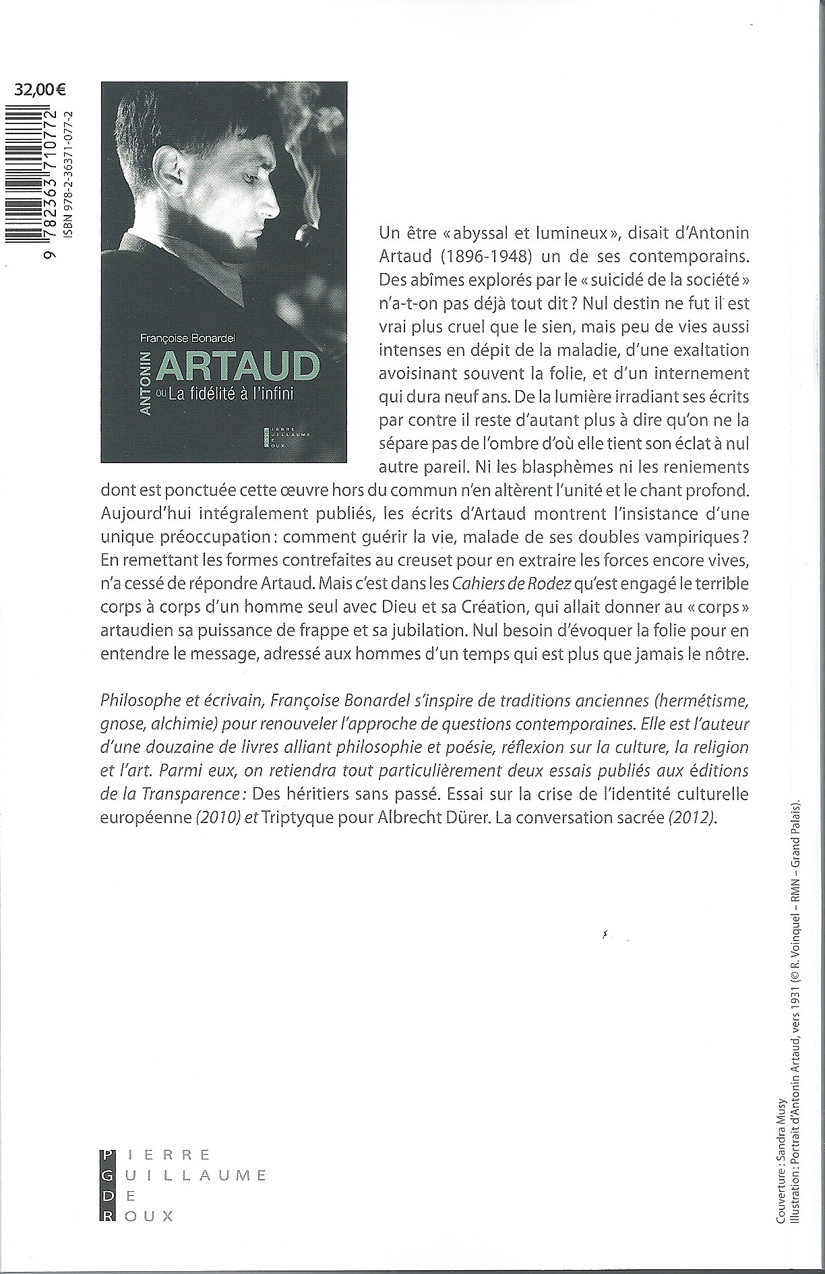
[1] A. Artaud, « Le théâtre alchimique », Œuvres, Paris, Gallimard, (« Quarto »), 2011, p. 532.
[2] Les pages des citations mentionnées dans le texte renvoient soit aux différents volumes des Œuvres complètes publiées chez Gallimard, soit au volume des Œuvres dans la collection « Quarto ».
[3] A. Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, Œuvres, op. cit., p. 1444.
[4] R. Alleau, Alchimie, Paris, Éditions Allia, 2008, p. 79.
[5] Cité dans F. Bonardel, Philosopher par le Feu – Anthologie de textes alchimiques, Paris, Almora, 2009, p. 59.
[6] A. Artaud, « Le théâtre et la culture », Œuvres, op. cit., p. 507, 509.
[7] A. Artaud, Lettres à Génica Athanasiou, Paris, Gallimard, 1969, p. 115-116.
[8] A. Artaud, « Les malades et les médecins », Œuvres, op. cit., p. 1086.
[9] A. Artaud, Œuvres, op. cit., p. 1540.
[10] A. Artaud, Œuvres, op. cit., p. 532.
[11] M. Eliade, Forgerons et alchimistes, Paris, Flammarion (« Champs »), 1977, p. 180.
[12] A. Artaud, Œuvres, op. cit., p. 567.
[13] A. Artaud, Héliogabale ou l’anarchiste couronné, Œuvres, op. cit., p. 459.
[14] A. Artaud, Œuvres, op. cit., p. 422.
[15] Op. cit., p. 429.
[16] Op. cit., p. 407.
[17] R. Guénon, Le Théosophisme, Paris, Éditions traditionnelles, 1928, p. 449-450. Cf. F. Bonardel, « Poésie et Tradition – Artaud lecteur de Guénon », in Modernités d’Antonin Artaud, Paris, Lettres nouvelles Mignard, 2001, p. 119-148.
[18] A. Artaud, « Le Théâtre et l’alchimie », Œuvres, op. cit., p. 533.
[19] A. Artaud, op. cit, p. 410.
[20] A. Artaud, « Un athlétisme affectif », Œuvres, op. cit, p. 589.
[21] A. Artaud, Héliogabale ou l’anarchiste couronné, Œuvres, op. cit., p. 445.
[22] A. Artaud, « Le Théâtre et l’alchimie », Œuvres, op. cit. , p. 535.

Laissez un commentaire