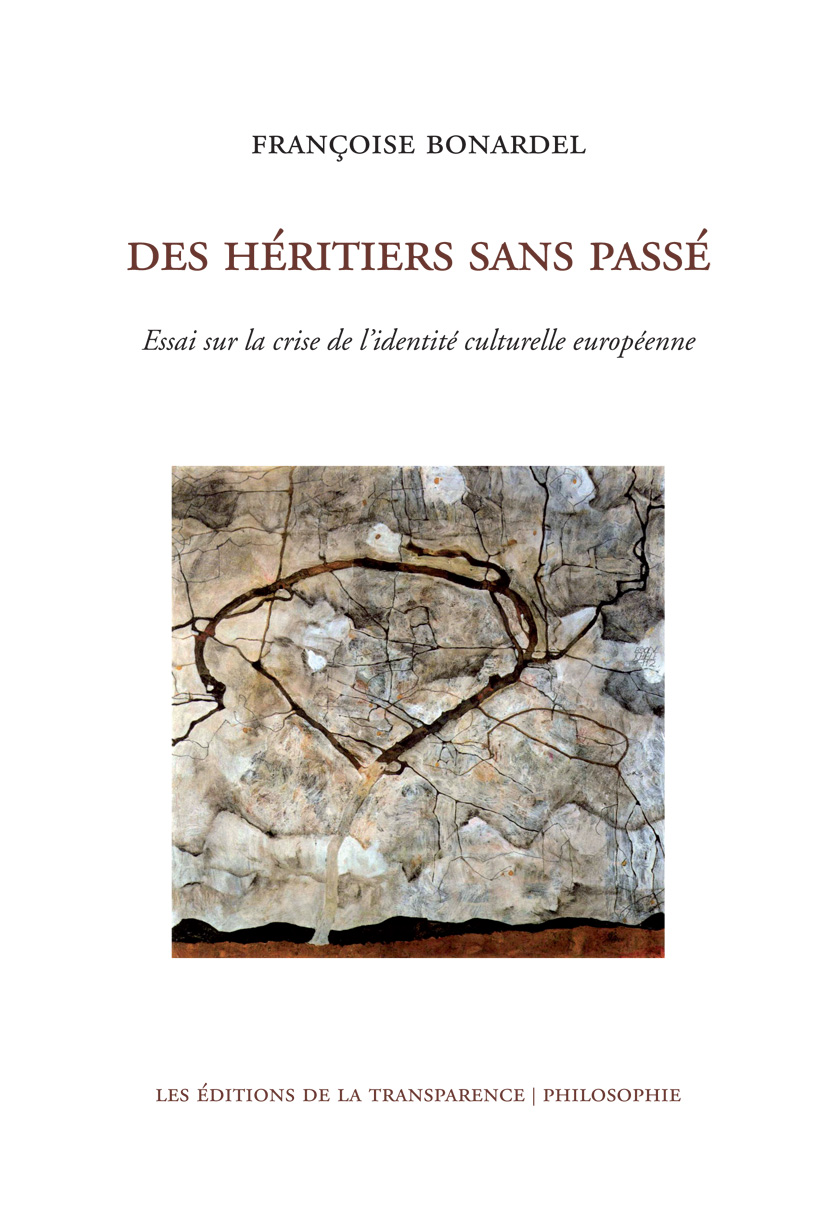
Bonardel : Une « étrangeté scandaleuse », vraiment ? Restituons en ce cas au mot scandale son sens premier (pierre d’achoppement), et demandons-nous pourquoi nous en sommes venus à trébucher mentalement dès qu’il est question d’identité européenne. L’Europe serait-elle la seule contrée à qui serait refusé le droit d’évoquer son identité, complexe certes, stratifiée, mais pourtant bien réelle ? Il est vrai que le mot « culture » a plusieurs sens dont l’un le rapproche de la notion de civilisation, au sens ethno-anthropologique du terme : ensemble des modes de vie, idéaux et croyances propres à un peuple à un moment donné de son histoire ; tandis que l’autre – et c’est à lui que je m’intéresse principalement dans mon dernier livre (Des héritiers sans passé ) – associe culture et « formation » de l’individu (Bildung) en fonction des valeurs de son milieu et de son temps bien sûr, mais aussi en vue d’un accomplissement personnel, voire d’un destin qui lui serait propre.
Or le trait le plus marquant de la « culture européenne » me paraît d’avoir cherché et souvent trouvé un remarquable équilibre entre ces deux aspirations : obtenir de chaque individu ce qu’il a d’unique et de meilleur tout en modelant de façon cohérente et inspirante la physionomie extérieure, le paysage collectif qui constitue aujourd’hui encore notre environnement. Je ne dis pas que tout marchait merveilleusement bien dans le passé, mais je constate que cette dynamique est aujourd’hui bloquée, et cela au moment même où la construction de l’Europe est devenue une priorité. Je ne prétends pas davantage faire le recensement de toutes les cultures locales qui, telles les pierres d’une immense mosaïque, ont peu à peu façonné cette entité culturelle, intellectuelle et spirituelle que l’on peut dire « européenne ». C’est en réexaminant avec admiration et respect, tendresse aussi, quelques-unes des œuvres majeures du patrimoine européen que j’en suis venue à reconstituer l’identité culturelle d’une Europe dont les divers visages semblaient jusqu’alors tournés vers un même horizon. Il y a bien une spécificité du regard européen sur soi-même et sur le monde – je rejoins sur ce point Jean-François Mattéi – qui conforte la légitimité d’une telle vision par rapport à la culture prétendument universelle que l’on cherche à nous imposer, et qui n’est au mieux qu’une vaste banque de données quand elle ne procède pas au nivellement pur et simple des identités.
J.-F. Mattéi : Il y a deux sortes d’étrangeté dans la culture européenne, ou deux pierres d’achoppement pour reprendre l’image du scandale de Françoise Bonardel. L’étrangeté des élites européennes actuelles à l’égard de leur propre culture qu’elles ont délaissée sans remords. C’est en ce sens que René Char pouvait écrire en 1943 dans Feuillets d’Hypnos : « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament ». Qu’elles soient politiques, universitaires ou artistiques, ces élites intellectuelles, à peu d’exceptions près, ont occulté ou critiqué la culture séculaire dont elles avaient hérité en n’en transmettant plus les principes. Les testaments ont été trahis pour reprendre une autre image due à Milan Kundera. Là où la tradition avait instauré une continuité dans les œuvres humaines, la modernité a imposé des ruptures qui se sont multipliées depuis la fin du XIXe siècle dans tous les domaines. La culture s’est réfugiée dans les musées et les bibliothèques pour devenir un écho savant du passé, mais elle a perdu toute ressource véritable, c’est-à-dire tout retour aux sources de la création. Nietzsche avait déjà dénoncé cette survivance historique qui est une maladie de langueur. La seule tradition qui s’est imposée a donc été celle de la rupture. Elle a conduit à fragmenter le monde de la culture traditionnelle, au sens de la formation de l’homme, la Bildung allemande reprenant l’idée de la cultura latine et de la paideia grecque, dans l’espace indifférent des comportements sociaux.
Mais il y a une étrangeté plus initiale, et constitutive, de la culture européenne classique. C’est précisément l’ouverture de cette culture à ce qui n’est pas elle, c’est-à-dire à l’étranger. Et cette étrangeté n’est pas scandaleuse, mais créatrice. La culture de l’Europe, depuis sa naissance dans les mondes grec et latin, s’est constituée par strates successives en absorbant les connaissances des cultures différentes qu’elle a découvertes. Déjà Platon, après Hérodote, saluait la grandeur de la civilisation égyptienne tout en l’intégrant dans le monde du logos et en affirmant que ce que les Grecs avaient reçu des autres peuples, ils l’avaient poussé à la perfection. Je rappelle, dans Le Regard vide, que le mot d’ordre de la culture de l’Europe, comme de sa politique, a été la formule de Charles Quint, Plus ultra, qu’il traduisait en français par Plus Oultre. Il s’agissait pour lui, et toute notre culture a suivi cet impératif, de passer les bornes de la connaissance et du monde pour ouvrir le regard européen à de nouveaux horizons. C’est ainsi que s’est imposée l’idée d’un universel de fait, et non seulement de droit, et que l’anthropologie a pu découvrir d’autres cultures qu’elle a aussitôt théorisées dans sa propre culture. Claude Lévi-Strauss en est le meilleur exemple.
P.-Y.Rougeyron : La culture n’a-t-elle pas cependant pour vocation de développer chez l’individu le sens de l’universel ?
Bonardel : Bien sûr, mais pas dans n’importe quelles conditions et à n’importe quel prix ! La question se pose avec force au moins depuis Goethe évoquant pour la première fois l’émergence d’une « littérature universelle ». Or Goethe, pour ne parler que de lui, était trop attaché à ce qu’implique la notion même de Bildung pour qu’on lui prête une quelconque sympathie envers une mondialisation mercantile ou faussement humanitaire de la culture. L’acte de se cultiver était à ses yeux une disposition de l’être toujours singulière, une tournure d’esprit personnelle permettant à l’individu de prendre simultanément conscience de soi et de ce que comporte d’universel sa propre culture, en dépit ou à cause de ses traits particuliers. Or la mise sur le marché mondial des biens de consommation culturels a produit ce qu’on appelle aujourd’hui le Mainstream – le courant dominant ! – et non une véritable universalité, au sens philosophique du terme. Une nouvelle forme de totalitarisme est ainsi en train naître, tout aussi barbare que celui d’antan visant à façonner un homme prétendument nouveau car destitué de toutes ses particularités individuelles. On ne peut à mon sens parler de culture que si l’universel trouve à s’incarner dans une forme, nécessairement individuée pour être reconnaissable, à travers laquelle il rayonne d’un éclat nouveau. C’est pourquoi tout philosophe qui cherche à penser la notion de culture se découvre à mon sens plus hégélien que platonicien ; Platon invitant à se détourner du multiple – et donc des œuvres de culture qui suscitent aujourd’hui notre admiration – et à porter son regard vers un Ciel intelligible supposé commun à tous les êtres humains.
Vous remarquerez d’ailleurs que la plupart des philosophes se sont moins intéressés à la culture, au double sens du terme, qu’à la formation intellectuelle de l’individu en vue d’un meilleur équilibre social. Je pense pour ma part qu’une « formation » ne saurait être purement intellectuelle sans générer tôt ou tard une forme de barbarie, et que c’est peut-être là le point faible de la philosophie, telle qu’elle s’est imposée en Occident tout au moins. Une « grande culture » – j’emploie hélas cette expression au passé en ce qui concerne l’Europe – est par contre reconnaissable à ce qu’elle touche et met simultanément en mouvement des couches aussi bien inconscientes que supra conscientes de la psyché humaine. C’est aussi pourquoi j’attribue moins la montée actuelle de l’insignifiance à la perte du regard transcendantal, comme le fait avec brio Jean-François Mattéi, qu’à une faille secrète dont la mise au jour pourrait être en soi thérapeutique : de quelle fatalité était donc porteur ce type de regard pour qu’il soit devenu si vide ? Aussi la crise d’identité qui affecte la culture européenne me semble-t-elle l’ultime manifestation du nihilisme prophétisé par Nietzsche ; crise que trop peu de philosophes prennent à mon sens au sérieux, comme s’il s’agissait là d’une simple option philosophique sans portée réelle ou aisément récusable.
J.-F. Mattéi : La culture européenne a bien été la matrice de ce que l’on appelle l’universel. Elle est même la seule à avoir systématiquement exploré toutes les facettes de l’universel, pensé depuis les Grecs comme logos, et appliqué aux vérités scientifiques, aux démarches philosophiques, aux exigences éthiques et aux droits politiques. Il y a une sorte d’ivresse de l’universel en Europe qui est d’autant plus paradoxale que cette universalité est née sur un continent particulier et dans un ensemble de cultures singulières. Toute la difficulté de l’Europe actuelle tient, me semble-t-il, à cela. Les autres civilisations et les autres cultures étaient également centrées sur elles-mêmes, c’est-à-dire sur leur propre univers, tout en s’identifiant à l’humanité. Lévi-Strauss remarquait ainsi que les sociétés primitives identifient l’humanité à leur peuplade, les autres peuples étant d’emblée exclus. Le terme d’Inuit, par exemple, signifie « les hommes ». Mais les penseurs européens sont allés plus loin dans cette appréhension de l’universel. Ils ne l’ont pas identifié à leur particularité, en tirant en quelque sorte l’universel vers eux ; ils ont pensé abstraitement l’universel comme universel, c’est-à-dire, selon Hegel, au « concept ». Et ce concept d’universel, qui est applicable à tout chose de l’univers, en est venu à qualifier l’être humain lui-même, en d’autre termes sa conscience. Cela explique que, dans la lignée de l’humanisme traditionnel qui a connu son acmé au XVIe siècle, les différentes Déclarations des droits, de la Magna Carta des Barons anglais aux Déclarations des droits de l’homme, ce soit toujours l’universel qui soit visé à travers des situations particulières. La culture européenne, à tout moment, s’installe, comme si c’était son champ privilégié, sur le terrain de l’universel. C’est là seulement qu’elle se sent à l’aise.
Ce n’est évidemment pas sans danger. Comme il y a un mauvais infini pour Hegel, l’infini abstrait qui se détourne de la réalité finie, il y a un mauvais universel, un universel qui se complaît dans l’abstraction en reniant son ancrage dans le monde concret. Quand je parle, dans Le Regard vide, comprenons vide aujourd’hui de sens, d’un « regard transcendantal » porté sur des idées régulatrices au sens kantien, ce n’est pas pour ignorer les réalités sensibles et particulières. La grandeur de la culture consiste à concilier ce que Lévi-Strauss appelait un « regard éloigné », celui qui porte sur des idéalités et des modèles, et un regard proche qui tient compte du monde dans lequel on vit. Si ce regard européen porte, comme le dit bien Françoise Bonardel, une sorte de « fatalité », c’est parce qu’il a parfois cristallisé un tel éloignement de son point de départ qu’il a perdu ses repères. À force de s’éloigner de sa propre source, il est devenu critique à son propre égard et n’a eu de cesse que de démonter ou de déconstruire ses fondements. L’esprit critique de l’universalité porté à incandescence devient autodestructeur.
P.-Y. Rougeyron : Pourriez-vous revenir que les termes de cosmopolitisme et d’enracinement qui ont d’une certaine manière mis en tension la culture européenne ?
Bonardel : Je suis tout à fait consciente de soulever là une question devenue quasiment tabou, et j’impute au nazisme le fait d’avoir à ce point perverti le sens du mot « enracinement » que nous subissons par contrecoup les conséquences d’un déracinement systématique supposé purificateur mais qui s’avère incompatible avec l’ancrage, au moins temporaire, requis par toute « formation » de l’être humain. Quel courage et quelle lucidité ne fallut-il pas à Simone Weil pour oser écrire en 1943 L’enracinement ! Mais je considère parallèlement que la postmodernité intellectuelle continue à se recommander d’un cosmopolitisme tour à tour trop abstrait pour produire des œuvres de haute culture, ou trop concret (mondialisation des échanges) pour prétendre à l’universel. Nous sommes de ce fait dans une impasse, faute du ressort capable de remettre en phase ces deux postulations également légitimes qui, dissociées comme elles le sont aujourd’hui, produisent deux types d’absurdité, chacune porteuse d’une forme spécifique de barbarie : par hypertrophie de la revendication communautariste par exemple ou, à l’inverse, par inflation d’un pseudo universel en quoi chaque déraciné pense trouver une planche de salut.
Je prends donc dans ce livre à témoin la « grande culture européenne » qui est parvenue à porter les vertus de l’un (l’enracinement) comme de l’autre (le cosmopolitisme), et appelle qui sait encore l’entendre à un dépassement de cet antagonisme stérile. Loin d’être le signe d’un particularisme coupable, la redécouverte de leur patrimoine culturel par les Européens serait le meilleur gage de leur intérêt réel pour les autres cultures, et la seule voie d’accès à un universel concret. Nous sommes loin, vous l’aurez compris, des délires nazis relatifs au Heimat, et de l’idéologie communiste non moins totalitaire qui a rayé de la carte des millions d’êtres humains. Je persiste à penser que si la « grande culture européenne » n’a pas réussi à enrayer la barbarie nazie c’est qu’elle avait perdu tout pouvoir et tout crédit face à la culture de masse qui la supplantait en Europe. Mais en soi la culture reste encore – mais pour combien de temps ? – l’ultime rempart contre la barbarie qui est, comme le fut au temps de Platon la sophistique, un genre éminemment glissant et mutant. Aussi peut-on s’inquiéter de ce que l’idéal prétendument cosmopolite de la société marchande réunisse les conditions d’un nouveau totalitarisme, et de ce que la nouvelle culture de masse évacue à ce point le discernement que l’on ne sache plus distinguer le poison du remède. On comprend pourquoi Nietzsche appelait le philosophe de demain à devenir le « médecin de la civilisation » !
J.-F. Mattéi : L’antagonisme entre le cosmopolitisme, c’est-à-dire l’inscription dans le monde, et l’enracinement, c’est-à-dire l’inscription dans une culture, me paraît un faux débat. Les plus grands esprits de l’Europe, les Léonard de Vinci, les Shakespeare, les Goethe, les Mozart et les Cézanne, ont été enracinés sans difficulté dans le sol qui était le leur, géographiquement comme historiquement, et n’ont jamais renié leurs traditions. En même temps, ils étaient ouverts sur le monde au même titre que les Stoïciens qui ont été les premiers à parler de « cosmopolitisme » en se déclarant « citoyens du monde », et non d’Athènes ou de Corinthe. Socrate lui-même, qui n’avait jamais quitté sa cité en dehors de deux ou trois épisodes et qui prétendait être le seul Athénien à savoir ce qu’était la politique, disait qu’il habitait le monde et non sa ville natale. Dès l’origine, le philosophe a voulu concilier, non seulement l’un et le multiple, mais l’universel et le particulier, l’indigène et l’étranger. Phèdre disait de Socrate, dans le dialogue éponyme, qu’il faisait l’effet d’un étranger dans sa propre ville. Les autres Athéniens comprirent mal l’étrangeté du philosophe, c’est-à-dire son aspiration à une recherche universelle, et le mirent à mort.
Il me semble, pourtant, que les grandes créations de la pensée trouvent leurs racines aussi bien dans le sol terrestre que dans l’espace céleste, conciliant sans souci le particulier, la racine, et l’universel, le fruit. Prenons le cas de Jorge Luis Borges. Le penseur et poète argentin était le plus cosmopolite des hommes de son époque, en Argentine où il est né et à Genève où il est mort. Un cosmopolitisme de langue, de culture, de poésie et d’humanisme qui le conduisait à dire que, comme Homère le poète aveugle, il était tous les poètes et tous les aveugles, comme s’il n’y avait qu’un seul homme sur terre. Voilà pour l’universalité du cosmopolitisme. En même temps, il était le plus Argentin de tous les Argentins et n’a jamais renié le sol de sa patrie, le rythme du tango et le souvenir des truands de Buenos-Aires. Dans l’un de ses contes, L’Aleph, il trouve l’aleph, ce point minuscule qui englobe l’espace de l’univers et qui reflète, en un jeu de miroirs infini, tous les miroirs de la terre, dans la cave d’une maison de la rue Garay, à Buenos-Aires, à la hauteur de la dix-neuvième marche de l’escalier. On ne saurait mieux concilier, poétiquement il est vrai, le singulier et l’universel ! Je dirais la même chose de Kafka et de Prague, de Camus et de l’Algérie ou de Soljenitsyne et de la Russie. Tous sont enracinés dans leur patrie, mais la singularité de leur écriture les a portés, et même élevés, à l’universel car ils ont réussi à faire vibrer cette condition humaine que nous avons tous en partage.
P.-Y. Rougeyron : Dans vos ouvrages respectifs – Des héritiers sans passé, Le Regard vide – vous soulignez l’éloignement des Européens par rapport à leur culture. Pouvez-vous en faire la généalogie ?
Bonardel : Je ne sais si c’est le terme d’éloignement qui convient car cela supposerait un acte volontaire, délibéré, comme si les Européens avaient un jour décidé de se détourner d’un passé devenu caduc. Telle fut certes la rupture voulue par les penseurs des Temps modernes, tournant le dos au passé pour fonder une ère nouvelle. N’est-ce pas comme si Descartes n’avait jamais lu les philosophes grecs ? Si l’éloignement dont vous parlez a incontestablement pour plus proche origine une telle cassure permettant d’opposer l’ancien au moderne comme on le fait si souvent aujourd’hui, je persiste à penser qu’il vient de plus loin et que la modernité est elle-même la conséquence d’un mouvement de fond plus ancien. Je fais à cet égard mienne la thèse de Heidegger, initiée par Nietzsche, quant au dévoiement de l’esprit philosophique par la rationalité calculatrice ; et si je me suis tant intéressée à l’alchimie, c’est parce qu’on peut y découvrir les semences d’une philosophie de la culture et de la vie à laquelle se rapportent d’ailleurs spontanément, sans même en être forcément conscients, nombre des penseurs pour qui faire œuvre est plus important que forger de nouveaux concepts.
Je préfère donc parler de surdité, de cécité à l’endroit d’un patrimoine culturel que les Européens hésitent ou répugnent à se réapproprier, comme s’il y avait là une sorte de péché mortel contre l’universel et comme s’il fallait, pour s’intéresser aux autres cultures, renier celle qui vous a formé. Or l’appropriation est une autre histoire : celle de tout individu qui entreprend de former son intelligence, sa sensibilité, au contact du patrimoine qui lui a été légué et qui, forcément délimité au départ, pourra peut-être un jour englober toutes les œuvres majeures dues au génie humain. D’où le titre provocateur de mon livre : héritiers, les Européens le sont bien, mais d’un passé qu’ils méconnaissent ou renient faute de savoir se le réapproprier ; la culture étant moins un savoir que la rumination lente, et si possible inspirée, des expériences qui ont modelé les divers visages de l’humanité. Or je plaide dans ce livre pour que l’on en finisse avec l’outrecuidance du « moderne » qui ne serait qu’un jeu d’écume sans le passé sur lequel il ne cesse, quoi qu’il en dise, de s’appuyer. Quel soulagement, quelle liberté d’esprit ce serait de pouvoir se dire à la fois ancien et moderne comme l’ont d’ailleurs plus ou moins été tous les hommes de haute culture qui ont façonné celle dont pourrait à bon droit s’enorgueillir l’Europe.
J.-F. Mattéi : Il est vrai que la « modernité », pour reprendre le néologisme de Baudelaire, s’est constituée comme une suite de ruptures, de plus en plus rapides et de plus en plus violentes, on le voit en art, comme si elle était désireuse de tourner la page, non seulement des Anciens, mais même des Modernes. Ne va-t-on pas jusqu’à parler aujourd’hui des Postmodernes, et bientôt sans doute des Post-postmodernes ? Nietzsche l’avait déjà pressenti : « Notre culture européenne tout entière se meut depuis longtemps déjà, avec une torturante tension qui croît de décennies en décennies, comme portée vers une catastrophe : inquiète, violente, précipitée : comme un fleuve qui veut en finir, qui ne cherche plus à revenir à soi, qui craint de revenir à soi »[1]. Il y a une fuite en avant de la rationalité européenne qui cherche à échapper à ses propres limites, à son enracinement et à sa source, comme si elle ne gagnait sa bonne conscience qu’à en avoir une mauvaise. Il faut dire qu’elle a réussi sur tous les tableaux, en fonction du moins de ses principes universels, dans la science (les systèmes rationnels de Newton à Einstein), dans la technique (toutes les inventions depuis le XVIe siècle sont dues à des Occidentaux), dans l’économie (le capitalisme et le socialisme), dans la politique (la démocratie), dans la morale (les droits de l’homme) et même dans l’art (toutes les ruptures artistiques depuis Dada se sont généralisées à la planète entière).
La rupture la plus grande, et la plus hypocrite, a été celle avec son propre succès. Plus la culture européenne avec son prolongement occidental américain a dominé le monde, et plus elle s’est sentie coupable d’opérer une telle colonisation des esprits, plus intense que la colonisation économique ou politique. Il faut bien comprendre qu’au vingtième siècle, et c’est cela qui a pris les noms de « globalization » ou de « mondialisation », tous les peuples et les États de la planète se sont rangés, la Chine comprise, de gré et non pas de force, sous la bannière des modèles européens en tous domaines. Cette ouverture excessive, pour ne pas dire, cette sortie hors de soi, a dénoué les liens historiques et éthiques qui reliaient la culture européenne à ses fondements. Elle se complaît aujourd’hui, depuis la seconde guerre mondiale et la décolonisation, dans un désaveu de soi qui lui sert, sans doute pour compenser, de bonne conscience.
P.-Y.Rougeyron : Quelles en sont selon vous les conséquences actuelles et, même si cela est pour l’heure incertain et ambigu, les conséquences potentielles ?
Bonardel : Il n’est qu’à lire Kierkegaard et Nietzsche, ou les essais en prose de Baudelaire, pour se rendre compte que ces conséquences, aujourd’hui patentes, étaient au XIX°siècle déjà palpables même si on assistait parallèlement, et c’est là une confrontation troublante, à la mise en valeur institutionnelle du patrimoine culturel. Musées, galeries d’art, bibliothèques, salles de spectacles attirent de nos jours un public nombreux tandis que les échecs scolaires se multiplient et que l’inculture s’affiche ouvertement : appauvrissement du langage, stéréotypie des références, décontextualisation des énoncés, manque alarmant de discernement. En serait-on venu à compenser par des visites ritualisées sur les lieux saints de la culture la perte de ce que l’on n’est plus capable de vivre au quotidien ? Antonin Artaud s’était ému dès les années 1930 de ce que la culture ne modelait plus en Europe les gestes en apparence les plus anodins de chacun, comme c’était encore le cas au Mexique par exemple. Le plus difficile est donc aujourd’hui de renverser la tendance car si la plupart des œuvres de culture connues et répertoriées sont désormais disponibles, accessibles, elles ne peuvent contribuer à la « formation » de l’individu que si elles cessent d’être pour lui des biens de consommation.
Quant aux conséquences potentielles, elles sont pour une grande part déductibles de la situation présente et je m’interroge sur le type d’homme que le Mainstream est en train de fabriquer. Il est possible que nous assistions, impuissants, à une mutation typologique sans précédent du fait de la mondialisation qui se révèle d’ores et déjà à double tranchant : réaliser l’unification du genre humain, soudé par des intérêts économiques convergents, tout en créant l’illusion qu’il s’agit là d’une promotion de l’universel et d’une sympathie agissante à l’endroit des souffrances de son prochain. Mal à l’aise entre cet impératif d’ouverture inconditionnelle et la nécessité, pour se construire, d’assumer les fondements de son identité, l’Europe cultive de manière inquiétante le reniement de soi au profit de l’Autre, pur produit d’une culpabilisation lancinante entretenue par les médias, et finalement tout aussi fantasmatique que le culte du Moi.
J.-F. Mattéi : Pour être franc, et je suivrai ici les plus grands auteurs, de Nietzsche à George Steiner, et de Simone Weil à Hannah Arendt, je crains que les progrès de la culture, confinés dans les musées ou les maisons éponymes, ne constituent en réalité une régression des facultés créatrices de l’homme. Cet homme contemporain est devenu un consommateur d’objets culturels, c’est-à-dire de produits médiatisés et intégrés dans des circuits économiques. Tout a été dit sur ce point par Hannah Arendt dans La Crise de la culture quand elle montrait que la culture a été détruite en notre temps pour engendrer le loisir. « Le résultat n’est pas une désintégration, mais une pourriture » écrit-elle[2]. Dans La Barbarie intérieure, j’ai étudié ce pourrissement des œuvres, voire leur destruction programmée au même titre que la destruction des objets d’usage qui sont destinés à périr. Là encore, Nietzsche avait prévu que l’élargissement indéfini de la culture à tous les domaines d’existence, et à toutes les formes de consommation, signait la fin des œuvres, désormais confondues avec de simples produits. Toute la mémoire du monde est aujourd’hui à notre disposition dans cette bibliothèque infinie qu’est l’Internet, mais à notre disposition de consommateurs de produits virtuels. On peut visiter virtuellement, en trois dimensions, le Louvre ou tout autre musée, comme on peut visiter, pièce par pièce, le château de Versaille. En quoi ces visites imaginaires, éventuellement guidées, participent-elles d’une véritable formation aux œuvres ?
Les conséquences potentielles, mais déjà en voie de réalisation, sont la disparition des œuvres de la pensée au bénéfice de leurs alias virtuels. Nous entrons dans un monde que la réalité technique a rendu virtuel pour complaire aux consommateurs d’images que nous sommes devenus. L’entrée en scène d’un monde virtuel qui se substitue de plus en plus au monde réel, celui dans lequel on travaille, on souffre et on meurt « pour de bon », risque de faire entrer en scène également un spectateur virtuel qui sera emporté par son propre rêve. C’est déjà le cas avec les jeux vidéo de plus en plus « réalistes » qui font de la virtualité une réalité de plus en plus intense, voire , pour les amateurs, la seule réalité. On a vu, par exemple, un Japonais, connu sous le pseudonyme de Sal900, épouser légalement un personnage virtuel du jeu de simulation « Love Plus » sur console Nintendo.
P.-Y. Rougeyron : Un retour en arrière vous semble-t-il possible ?
Bonardel : Non, en aucune manière. Un tel « retour » reviendrait à opposer, une fois de plus, réactionnaires et révolutionnaires, conservateurs et progressistes. Or c’est de ce jeu de balancier que meurent à petit feu notre vie politique comme notre culture ! Ce serait occulter la marche inexorable du temps et son inépuisable fécondité : « On ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve », disait Héraclite. La question est donc moins d’en « revenir » à quoi que ce soit – le Paradis perdu, le bon vieux temps, etc. – que de faire à nouveau du présent le levier d’une réappropriation du passé en vue d’un à-venir par nature toujours plus ou moins incertain. On ne tronçonne pas impunément la temporalité qui est, Heidegger l’a bien vu, la substance même de l’être humain jeté en ce monde. C’est le sens de l’universel véhiculé par la culture qui est là aussi en jeu : ouverture aux autres certes, mais à condition que cet élargissement ne se transforme pas en béance identitaire privant du même coup de toute signification la notion même d’altérité ; à condition aussi que le triomphe du temps chronologique auquel se réfère obsessionnellement l’homme moderne, toujours si affairé, n’oblitère pas à jamais l’expérience vécue du temps et de l’espace qui, initiant chaque individu au tempo qui lui est le plus propre, le qualifiera un jour comme être de culture.
J.-F. Mattéi : Aucun retour en arrière n’est jamais possible, surtout dans la conception européenne du temps qui est orientée vers l’avenir. La flèche de l’histoire ne revient pas vers le passé qui l’a tirée. Il ne s’agit d’ailleurs pas de réactualiser un état de fait qui n’est plus que de repenser ce qui est toujours dans ses exigences éthiques. Quand l’historien allemand Léopold von Ranke écrivait que « chaque époque est immédiate par rapport à Dieu », il reconnaissait que chacun des moments de l’histoire se relie moins à ce qui se situe dans une aire proche qu’à ce qui lui donne son origine et sa fin. Bref, le sens de l’existence tient à ce qui la surplombe comme un principe supérieur, par exemple celui de la justice. Restaurer ce qui a éclairé le passé consiste plutôt à instaurer ce qui doit éclairer le présent et qui, comme disait Faulkner, n’est jamais passé. L’événement est toujours dépassé par l’advenue de nouveaux événements, mais les principes qui commandent la culture d’un homme ne sont jamais dépassés si l’on admet, ce qui est mon hypothèse, qu’il y a quelques chose de permanent dans l’être humain qui tient à sa condition finie. Mais, pour éclairer cette condition finie, il faut une source de lumière infinie qui n’est pas susceptible de s’épuiser.
P.-Y. Rougeyron : Si nous sommes dans la phase « liquide » ou de « fluidification » de la modernité, comme le souligne Baumann, comment penser la culture dans un environnement mouvant dénué de la notion de frontière et de limite ?
Bonardel : La question en effet se pose et j’ose dire qu’elle vise d’abord de plein fouet la modernité qui, fluidifiée, risque de perdre la force conquérante qui était la sienne sans que la culture s’en trouve pour autant revalorisée. Si chaque individu baigne, comme c’est déjà le cas, dans un « bouillon de culture » où tout et n’importe quoi peuvent revendiquer ce label, sans plus aucun repère autorisant à classer, hiérarchiser, alors c’en est doublement fini : de la « formation » de l’être humain, contraint de répondre sans discernement aux stimuli les plus proches, les plus séduisants ou les plus violents ; et de la modernité en tant qu’idéal des Lumières offrant à chaque homme les moyens de sortir de sa médiocrité. La survie de ce que l’Europe a durant des siècles nommé « culture » dépend donc de sa capacité à retrouver un juste et vivant équilibre entre identité et altérité, ouverture et clôture. De quel droit le lui refuserait-on alors que les pays dits « émergents » ne se privent pas de se donner une identité nouvelle grâce à un audacieux mélange de l’ancien et du moderne ? Une reconversion du Sapere aude kantien (ose savoir) s’impose : ose être toi-même, Européen !
J.-F. Mattéi : Zigtmen Bauman parle d’une société liquide lorsque les situations dans lesquelles les hommes agissent se modifient avant que leurs façons d’agir ne parviennent à se consolider en habitudes sociales. Pour lui, l’ère liquide des consommateurs a remplacé l’ère solide des producteurs pour fluidifier la vie dans une absence de sol stable. On retrouvait une image similaire chez Deleuze et Guattari quand, dans Rhizome, ils parlaient de « former des milieux » semblable à « des blocs friables dans des soupes »[3]. Si la modernité contemporaine, qui cherche à décomposer tout ce qui est architectonique, dans les œuvres, dans les institutions comme dans les hommes, se complait dans un monde de sables mouvants, aucun culture n’est plus possible. Toute culture, et d’abord cette agriculture dont Cicéron a tiré le terme de cultura, a besoin d’une terre dans laquelle les semences de la culture peuvent prendre racines et produire ensuite des fruits. La « déterritorialisation », encore un terme de Deleuze, interdit, dans sa fuite nomade vers le métissage des cultures, interdit à une culture véritable de porter des fruits. Ou alors, ce sont des fruits secs. Il n’y a de culture qu’à l’intérieur de limites fixes et mesurées comme le montre l’expérience de l’art, en premier lieu de la musique.
P.-Y. Rougeyron : Vous parlez à la fin de votre livre de « retour à l’atelier ». Est-ce là une forme de résistance à la déculturation que vous dénoncez ?
Bonardel : Sans aucun doute, et ce livre est un appel à l’insurrection pacifique des consciences. Chacun a le droit, le devoir peut-être, de s’opposer comme il l’entend au rouleau compresseur du Mainstream ambiant. D’autres l’ont dit avant moi, et Jünger écrivant en 1951 son Traité du rebelle évoquait un possible « recours aux forêts ». Le mot est d’ailleurs très juste : c’est de recours qu’il s’agit en fait, plus que de retour ; ce terme pouvant servir de prétexte à la récurrence nostalgique d’un passé révolu. Employant néanmoins ce mot dans le dernier chapitre de mon livre, j’invite chacun à découvrir pour son propre compte son lieu d’élection, plus symbolique que géographique faut-il préciser ; là où la « formation » de soi étant encore possible, des œuvres de culture pourront aussi voir le jour. Il ne vous aura sans doute pas échappé que si l’atelier est d’abord un lieu de création, il est également une sorte de cellule quasi monacale, et pour tout dire de sanctuaire où seraient préservés des gestes, des attitudes, des dispositions intérieures dont la disparition affecterait l’image que nous nous faisons de l’humanité, plus ou moins présente en chaque individualité. Enclos préservé, l’atelier favorise le jeûne de l’esprit permettant à chacun de redéfinir ses véritables priorités. Saurait-on, sans cela, se dire cultivé ?
J.-F. Mattéi : J’apprécie l’expression de Françoise Bonardel, qu’on pense l’atelier sur le mode du retour ou sur celui du recours. Claude Lévi-Strauss avait déjà regretté que les peintres modernes, depuis les Impressionnistes, aient perdu le goût du travail cultivé par la tradition. Dans son célèbre article sur « Le métier perdu », publié dans Le Débat en 1981, il notait que la maîtrise picturale était désormais inutile parce que la spontanéité du créateur, ou présumé tel, devait peindre aussi facilement que « l’oiseau chante ». Naturellement et sans effort. C’est la négation même de la culture qui demande, en toutes choses, un apprentissage et un effort. Il faut donc, tel est l’impératif catégorique de la création, revenir à l’atelier pour y faire ses armes ou s’asseoir devant le clavier pour y faire ses gammes. Quand Heidegger faisait remarquer, lui qui était un fils de tonnelier, que penser était peut-être du même ordre que « travailler à un coffre », c’est à ce lent travail de germination de la matière et de soi qu’il songeait.
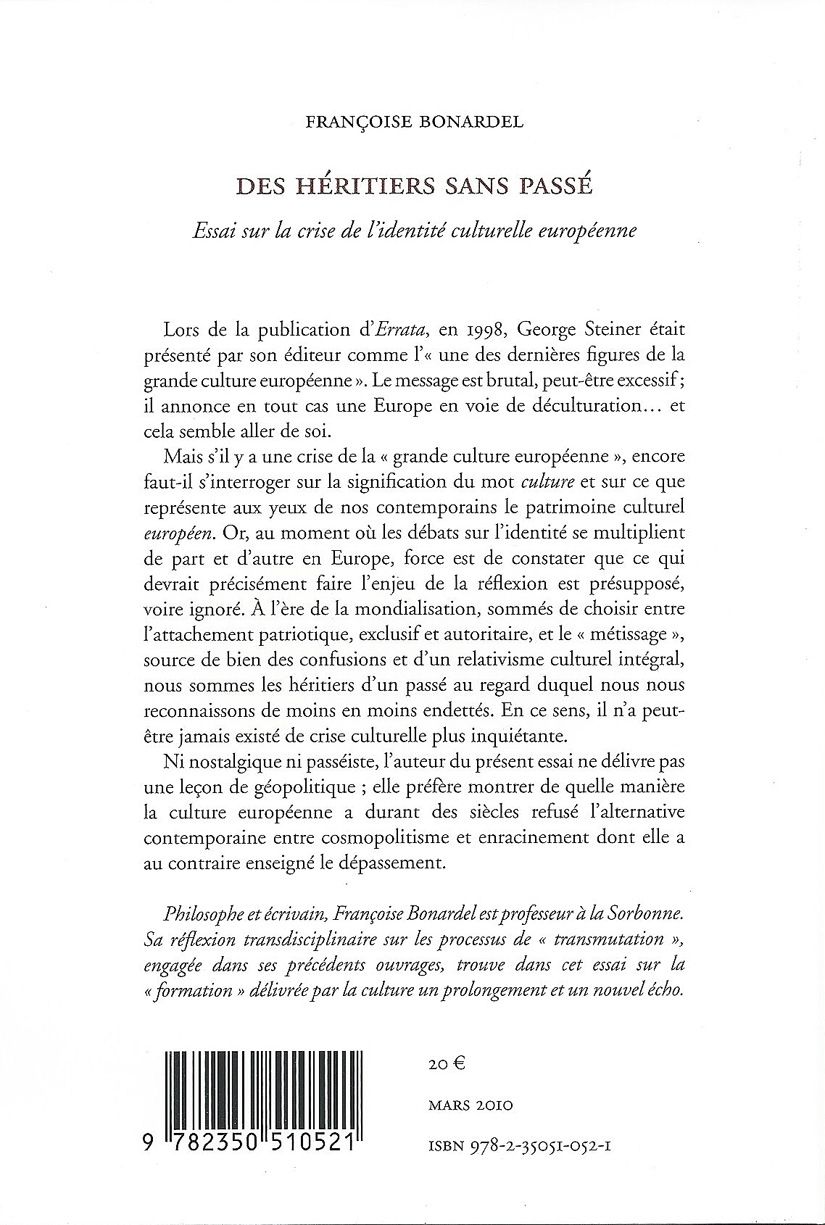
[1] F. Nietzsche, Fragments posthumes. Automne 1887-mars 1888, tome XIII, Paris, Gallimard, 1976, p. 362.
[2] H. Arendt, La Crise de la culture, Paris, Gallimard, 1972, p. 266.
[3] G. Deleuze et F. Guattari, Rhizome, Paris, Minuit, 1976, p. 71-72.

Laissez un commentaire